
Sommaire de critiques
sélectionnées, sur des activités
ou des oeuvres d'auteurs du
LESTAMP
Dernière en date
LE SENTIMENT ESTHETIQUE
Essai transdisciplinaire
Joëlle-Andrée-Deniot
Le Manuscrit Paris décembre 2017

Réactions au livre début 2018
Site
de la FNAC
Le sentiment du Beau est aussi universel que vital
Artélu, le 19 février 2018
Professeur de sociologie,
Joëlle-Andrée Deniot a dirigé à Nantes le Master
Expertise des Professions et Institutions de la
Culture. Obstinée à y maintenir les
fondamentaux, anthropologie, sémiologie,
histoire de la politique culturelle française
depuis mille ans, Histoire de l’art, elle a
refoulé de 2005 à 2017 la pression d’alignement
sur l’idéologie de l’État culturel langien,
attirant une audience internationale. Elle livre
de cette expérience le souverain achèvement, cet
essai audacieux totalement neuf. L’art, la
musique, la poésie, sont resitués dans les
invariants de leur sacralité. Une sacralité
ouverte à tous ; tous prédisposés au sentiment
esthétique. Les savoirs disponibles de sa
formation universitaire, philosophie,
sociologie,-sémiologie, alliés à ceux des
grandes expériences humaines, de la mystique à
la chanson française, sont conjugué pour
s’adresser au public cultivé comme au lecteur
expert, philosophe esthétique, anthropologue,
sémiologue, historien de l’art. Après la preuve
par l’œuvre d’une alternative compréhensive et
transdisciplinaire aux sciences sociales de la
chosification de la vie humaine, son « Édith
Piaf, la voix, le geste, l’icône », ce
livre-synthèse d’une vie de recherche veut
mettre fin à la tyrannie, aussi idéologique que
stérile, d’une « sociologie de l’art » à la
remorque du non-art officiel actuel de la
destruction du beau et du vrai. Il est de ceux
que l’on savoure, où l’on s’arrête, l’on revient
pour annoter, citer. C’est, à une scansion
historique de la crise culturelle française, le
livre nécessaire, osons même dire, vital parce
qu’alternatif aux dogmes mortifères de la mort
de l’homme, de la mort du bel art, du nihilisme
que les pensées serves ont mimé comme un seul
homme dans le sillage de la dite mort de dieu.
_______
Antépénultième :
LesTamp par
Dominique
DAGUETcliquer
Eric de BELLEFROID
(Edith
Piaf...)
Laurent DANCHIN*(Edith
Piaf..Youtube)
Dominique DAGUET,
Charles DREYFUS-PECHKOFF (Eros
et liberté)
Francis FARRUGIA (Actualité de
la pensée grecque)
Pascal FUGIER (Eros et société)
Claude JAVEAU
(Edith
Piaf....)
Bernard KAYSER (Ouvriers
de l'Ouest)
Jules LAUTER
(Edith
Piaf..)
Maxime LEROLLE
(Bel
ordinaire : j.
Deniot "un personnalisme
appliqué") Pierre NAVILLE
(Ouvriers
de l'Ouest) Gérard NOIRIEL
(Ouvriers
de l'Ouest)
Martyne
PERROT(Bel
ordinaire)
, Michel
PHLIPONNEAU (Ouvriers
de l'Ouest), Jacky REAULT
(Edith Piaf...)
Nathalie RONDEAU
(Edith
Piaf....)
Dominique TORRENTE
(Bel
ordinaire) Michel VERRET
Pour
Isabelle MARC
(Edith
Piaf..)
..
Revue Volume)
lire aussi
Réception
de l'Edith
Piaf de J Deniot réponse au tardif CR d'Isabelle Marc dans la revue Volume, aussitôt qu'informée du dialogue privilégié instauré avec J Deniot par le livre de D. Looseley.)
*Sous
forme d'interview à la Galerie
Delta Paris décembre 2013,
Youtube.
Avis de parution extérieurs au
Lestamp
(libraires en ligne non compris)
BNF (Edith
Piaf....)
Site des Lyriades (sur Eros et
liberté)
http://www.leslyriades.fr/spip.php?article689
Site Université de Nantes
Sociologie (sur Eros et liberté)
http://www.sociologie.univ-nantes.fr
_______
A propos de
"Le
décor ouvrier Le
bel ordinaire" de
Joëlle DENIOT,
L'Harmattan 1996
: Le
personnalisme sans la personne
Par
Maxime LEROLLE (via
https://organiste.blogspot.fr/2017/05/le-personnalisme-sans-la-personne.html
)

image:http://media.paperblog.fr/i/839/8396719/personnalisme-sans-L-T9z0Fb.jpeg
Par
bien des aspects, Emmanuel Mounier, le fondateur
de la revue
Esprit
et l'un des grands penseurs d'une ligne éthique
– le personnalisme – pour sortir de la crise des
années 30, est proche de Camus, de sa pensée, de
son style. Cette rhétorique de l'héroïsme
séduisant, multipliant les images, les paradoxes
à dépasser et la force aride des maximes – « Le
courage est d'accepter cette condition incommode
et de ne pas la renoncer pour les molles
prairies de l'éclectisme, de l'idéalisme et de
l'opportunisme »[1]par
exemple –, a cependant une faille béante au
centre de ce discours de la personne : aucune
personne concrète n'y est représentée.
De sorte que tout ce beau discours, énergique,
stimulant, galvanisant, n'est qu'un vent de mots
jeté dans le ciel des idées, alors qu'il
revendique l'imbrication essentielle de la chair
et de l'esprit.
Comment peut-on revendiquer l'émancipation
individuelle et collective dès lors que la
personne, non comme idée, mais comme réalité en
chair et en os, n'est réduite qu'à des mots
creux ? Quelle peut être la valeur d'une
libération uniquement discursive ? Bien souvent
l'amour du bon mot se substitue à celui d'une
personne réelle et ne conduit qu'à des formules
générales, vaines, et parfois hautement
discutables : « En
sacrifiant aux sollicitations du réel les voies
et les harmonies imaginées par nous, nous
gagnons une sorte de virilité, celle que
développent le nettoyage des naïvetés et des
illusions, l'effort continu de fidélité sur des
chemins déconcertants. »
L'amour sans bornes de l'héroïsme s'emplafonne
dans l'impasse du virilisme. Pas un hasard si
aucune femme n'est intégrée dans cette
rhétorique du héros.
Mais à trop me calquer sur le texte, je perds
moi-même la notion du réel et des personnes
concrètes. Plutôt que de continuer à parler
d'elles en des termes imprécis, je préfère
laisser la parole à des
personnalismes
appliqués.
Je parlais de la proximité qui existait entre
Camus et Mounier. La grande différence qui
existe entre eux, c'est probablement le fait que
Camus a été écrivain de fiction ; cela ne change
rien au style très littéraire de Mounier, mais
prouve qu'il lui manquait quelque chose que
Camus étudiait sous tous ses angles : des vies
humaines. Que ce soient l'anesthésie
sentimentale de Meursault[2],
les dilemmes éthiques et douloureux de Kaliayev
et Dora[3], ou l'héroïsme ordinaire de Rieux,
Tarrou, Grand et Panelou[4], c'est toujours la
personne, dans ses multiples possibilités
morales, qui est au cœur de son œuvre. Les
écrits théoriques ne sont pas en reste :
Le Mythe de
Sisyphe fait une
histoire concrète de l'évolution de l'idée
absurde dans l'Occident (exercice difficile
auquel se livre de temps à autre Mounier et dans
lequel il réussit) et
L'homme révolté
celle des vertus de la révolte face aux meurtres
commis par le nihilisme révolutionnaire. La
littérature chez Camus n'a de sens que si elle
célèbre ou critique des personnes qui acquièrent
chair et os au fil de la plume ; les mots ne
valent jamais en eux-mêmes, mais dans les
réalités sensibles qu'ils façonnent. Camus est
un penseur de l'esthéthique.
Plus encore que Camus, il y a Kundera, qui fonde
le principe de ses romans dans l'étude
psychologique et existentielle des personnages
qu'il invente, et qui semblent acquérir une vie
autonome en même temps que le narrateur, homme
comme les autres, s'écarte d'eux pour mieux les
découvrir. Tout le projet esth-éthique de
Kundera se résume à celui des
Gründen[5],
ces métaphores qui disent la manière dont chacun
de nous nous ancrons dans la terre, c'est-à-dire
la manière dont nous percevons l'existence. À
chaque individu, un ensemble de valeurs, de
métaphores, de sensations, que chaque roman se
doit d'analyser. Le monde romanesque de Kundera
est, à l'image du nôtre, un ensemble d'individus
dont l'intimité et les ressorts psychologiques
sont la base.
Sortons quelque peu de la littérature et allons
voir ce qui se fait dans une science, qui peut
en elle-même devenir un art : la sociologie.
C'est ainsi que
j'ai lu avec grand plaisir l'ouvrage de Joëlle
Deniot,
Le Bel ordinaire,
consacré à l'étude personnalisée de logements
ouvriers, pris dans leurs singularités
respectives et les traits caractéristiques de ce
type d'habitat. Loin de Bourdieu et de ses
propos souvent trop distants, trop abstraits,
trop hautains, Joëlle Deniot articule son
discours sur l'observation précise des décors de
ces petites demeures et les récits qu'en font
leurs habitants, et restitue pleinement par ce
biais toute la valeur humaine à des personnes,
trop longtemps envisagées comme masses à
libérer, ancrées comme toutes les autres dans un
monde qu'elles ont façonné et qui les ont
façonnées. Pour être au plus près de la morale
des gens qu'elle accompagne, Deniot pense une
morale du style universitaire, épuré ici de ses
références abondantes et abusives, passant tour
à tour de la description poétique à la parole
humaniste : le discours théorique qu'elle tient
naît comme une sécrétion florale à la surface
des êtres et des objets qu'elle décrit. C'est à
la suite de ce court mais bel ouvrage que j'ai
d'ailleurs écrit un mini-mémoire consacré à
l'étude de la créativité décorative au sein des
intérieurs dans une époque où la production
standardisée a remplacé la production manuelle.
Mais pour en revenir au personnalisme
de Mounier, concluons ainsi : tout discours sur
la personne doit être nourri de personnes. C'est
leur sang qui doit couler dans les veines du
texte, non une encre trop belle pour être vraie.
À la suite de Camus, Kundera, Deniot, et bien
d'autres auteurs encore, il nous faut penser un
existentialisme appliqué.
Le
personnalisme sans la personne,
Maxime LEROLLE
[1] Le
personnalisme[2]
L’Étranger[3]
Les Justes[4]
La Peste[5] C'est
dans L'immortalité qu'il
en parle le mieux.
----------------------
FUGIER PASCAL
Accueil du site > Numéros > N°17. L’approche biographique > Notes de lecture > Joëlle Deniot et Jacky Réault (dir.), Éros et Société. Vouloir vivre, vouloir (...)
http://www.revue-interrogations.org/Joelle-Deniot-et-Jacky-Reault-dir
Compte-rendu de l'ouvrage Eros et société.
Joëlle Deniot et Jacky Réault (dir.),
Éros et Société. Vouloir vivre, vouloir jouir, vouloir mourir, vouloir tuer

J
Joëlle Deniot et Jacky Réault (dir.), Éros et Société. Vouloir vivre, vouloir jouir, vouloir mourir, vouloir tuer, Cahier n°3, Nantes, Editions Lestamp Association, février 2012
Cet ouvrage collectif, dirigé par Joëlle Deniot et Jacky Réault (avec la contribution de Léonard Delmaire), réunit des textes issus du colloque organisé à Nantes en juin 2009 par l’équipe du Lestamp (Laboratoire d’Etudes Sociologiques des Transformations et Acculturations des Milieux Populaires), en partenariat avec le laboratoire Habiter PIPS de l’Université d’Amiens.
Contribuant à l’essor d’une socio-anthropologie des sentiments et des émotions, l’ouvrage se situe dans la continuité du colloque fondateur organisé par Joëlle Deniot en 2000 à l’Université de Nantes, Nommer l’amour. Les dix-sept chapitres agencés sont ponctués par
quatre interludes philosophiques, philologiques et littéraires, qui participent de l’originalité de l’ouvrage.
Par-delà la diversité des objets et des champs de recherche investis (l’art, l’autobiographie, la musique, l’École, les jeunes des cités, la criminalité, l’anorexie, etc.) et des disciplines (l’anthropologie, l’histoire, la littérature, la philologie, la philosophie, la psychanalyse, la psychosociologie et la sociologie), c’est autour de la thématique d’Éros, conçu comme mythe, symbole, schème et/ou concept, que près de vingt chercheurs se trouvent ainsi réunis.
Éros et civilisation d’Herbert Marcuse (Marcuse, 1963) occupe une place de premier plan dans deux articles, à commencer par celui d’Arno Münster, qui en propose une relecture critique. Y est introduite la thèse vitaliste et freudo-marxiste de la répression fondamentale et de la sur-répression des pulsions, leur désexualisation comme leur désublimation et leur canalisation au nom du principe de rendement capitaliste. L’enquête qualitative que
Laure Ferrand a menée auprès d’amateurs de rock, et présentée ensuite, renverse la thèse marcusienne [1], dans le sens où les concerts constituent un moment d’effervescence collective, de dépassement de soi et de décharge émotionnelle, en rupture avec l’ordinaire de la vie quotidienne et étranger à son principe de rendement. « Le concert de rock est l’expression paroxystique du principe de plaisir. » (p. 118).
Plutôt que de s’appuyer sur les travaux d’Herbert Marcuse, Clélia Van Lerberghe rend compte des différentes formes de l’Éros à partir de la phénoménologie du philosophe tchèque Jan Patočka et de sa conception des différents modes d’expression de la force vitale au sein des mouvements d’enracinement, de reproduction fonctionnelle et de percée de l’existence (p. 149).
Pierre Cam
propose pour sa part une relecture de l’étude fondatrice et controversée qu’Alfred Kinsey (Kinsey, 1948) a consacrée au comportement sexuel, sans écarter les critiques dont elle a été l’objet (concernant le mode d’échantillonnage, la conduite « musclée » des entretiens, l’implication idéologique des chercheurs…). Il souligne que si Alfred Kinsey interroge la sexualité et les relations conjugales en les inscrivant dans leur contexte socio-culturel et historique (l’effet déterminant de l’éducation, la religion, la classe sociale d’appartenance, la génération…), il les étudie aussi par le prisme de la trajectoire biographique de chaque partenaire, en s’intéressant en particulier aux expériences vécues durant l’adolescence. Il repère ainsi que la carrière sexuelle des femmes (dans l’acception beckerienne du terme) s’initie de façon moins institutionnalisée que celle des hommes, ce qui confère aux femmes « une large place à l’improvisation » (p. 67).
La polymorphie d’Éros transparaît au fur et à mesure des contributions. Aussi bien l’Éros platonicien et néoplatonicien que l’Éros freudien sont marqués du sceau de l’ambivalence, comme le soulignent Joëlle Deniot et Jacky Réault dans la présentation de l’ouvrage (p. 5).
Nous retrouvons cette insistance sur l’ambivalence de l’Éros dans l’analyse autobiographique que livre
Antoine Baczkowski, se référant à la fois au mythe d’Éros relaté par Platon et à la métapsychologie freudienne. Cette analyse le mène à l’hypothèse de sa « névrose de classe » (p. 141), en référence à la sociologie clinique de Vincent de Gaulejac.
Les textes de Marc Chatellier et de David Morin-Ulmann sont plus largement consacrés à l’Éros freudien. Le premier l’inscrit dans le champ éducatif, au sein duquel il défend l’importance d’instituer des espaces d’écoute au service des élèves en difficulté scolaire, reconnus comme des sujets désirants et dont la subjectivité est le terrain de conflits psychiques. Le second rend compte de la mise en scène cinématographique de l’inconscient pulsionnel freudien à partir d’un corpus de films d’horreur cultes. Selon lui, « la production cathartique d’images d’horreur [est] une des stylisations (culturelles) de la figure du Ça » (p. 272).
La complexité d’Éros est aussi relative aux concepts avec lesquels on l’associe. Ainsi, Éros se trouve lié au désir d’extimité [2] sous la plume de Gérard Dehier, à partir du fameux récit autobiographique que Catherine Millet consacre à sa vie sexuelle.
Amandine Cha-Dessolier lie l’érotisme et l’abject à partir d’exemples artistiques et s’intéresse ainsi à la « part maudite » de l’art, pour reprendre un concept cher à George Bataille et auquel se réfère l’auteur. Or, si l’interdit du dégoût sur lequel se fonde la représentation artistique demeure encore d’actualité, plusieurs artistes contemporains (comme Berlinde de Bruyckere, Andres Serrano…) s’efforcent d’établir l’abject au rang de catégorie esthétique, donnant ainsi à l’abjection artistique un rôledésublimatoire (p. 50), participant à la transgression de certains tabous.
Les actes transgressifs sont aussi traités par
Delphine Colas
qui s’intéresse aux femmes condamnées pour crime passionnel à l’encontre de leur conjoint ou compagnon. Les récits qu’elles lui livrent situent les problématiques liées à l’excès ou au défaut de socialisation de leur ’identité de femme’ au fondement de leur acte criminel. La figure maternelle y joue alors souvent un rôle (contre-)identificatoire central. Mouvement inverse du geste criminel, l’incorporation des poussées excessives d’Éros est évoquée dans la contribution de Karine Briand
consacrée aux personnes anorexiques et dont elle retrace la carrière à partir des recherches menées par Muriel Darmon (Darmon, 2008).
Anne Helias recueille elle aussi des récits mettant en intrigue la passion amoureuse qui, comme « figure, extrême, du désir » (p. 196), peut occasionner bien des excès et des tragédies qui semblent échapper à la raison ou à la « pensée raisonnable » (p. 202). Elle complète son recueil de données par l’analyse de récits de passion amoureuse émanant de romans et films d’amour, et ce n’est alors plus la mère mais l’imaginaire cinématographique qui constitue un véritable modèle identificatoire. De plus, Anne Hélias tâche de faire transparaître la forme archétypale des récits de passion amoureuse, qui se structurent selon elle en trois « mythèmes » : « l’obstacle ou l’amour interdit, l’ambivalence ou le dilemme, l’issue fatale ou la chute : la résolution dans la mort. » (p. 204).
À la marge de la thématique de l’ouvrage, Sébastien Peyrat traite du rapport à la loi qu’ont les jeunes des cités. À l’opposé des thèses enfermant cette population dans l’anomie, l’auteur insiste sur la manière dont la vie quotidienne dans la cité est régulée par un ensemble de normes et de valeurs reconnues par les jeunes et qui y sont établies et transmises selon des modalités genrées et intergénérationnelles. L’entraide et la solidarité sociale des jeunes entre eux constituent « une culture d’Éros social » (p. 98) qui peut s’organiser au détriment de la vie privée et de l’intimité de chacun.
Joëlle-Andrée Deniot revient sur les images qui se sont imposées à elles lorsque le thème d’ « Éros et société » s’est profilé. C’est ainsi sur le terrain de l’art pictural, de la sculpture et du cinéma qu’elle questionne Éros. Or, ses différentes figurations sont selon elle construites sur « deux schèmes se combinant à savoir, d’une part le schème de l’augmentum (état de crise culminante dont on ignore le dénouement) et d’autre part le schème du regard latéral, de sauvegarde (tant esthétique que morale) de l’angle mort » (p. 230). Parmi les illustrations commentées par l’auteur, nous trouvons particulièrement éclairante celles relatives au film Hiroshima mon amour (Resnais, 1959), mise en scène de l’ouvrage de Marguerite Duras, et qui permet à Joëlle Deniot d’interroger « la force thanatique et vitale de l’oubli » (p. 242) ainsi que la figuration obscène de la douleur que peut provoquer la mort de l’être aimé.
Enfin, Jacky Réault apporte un éclairage historique du concept, en interpellant notamment Éros à partir de Narcisse qui, structurellement, « est mime inversé d’Eros » (p. 291).
Cet ouvrage collectif permet d’élucider les différentes formes et figures que peut incarner Éros, en étudiant notamment son enracinement mythologique et son fondement archétypal. Il rassemble des chercheurs aux affiliations institutionnelles très diverses, qui participent de son originalité et de sa portée heuristique, à contre-courant de l’esprit de paroisse qui tend à régner dans nombre de colloques universitaires…
Bibliographie
Darmon Muriel (2008), Devenir anorexique. Une approche sociologique, Paris, La Découverte.
Kinsey Alfred (1948), Le Comportement sexuel de l’homme, Paris, Pavois.
Marcuse Herbert (1963), Eros et civilisation, Paris, Minuit.
Tisseron Serge (2011), « Intimité et extimité », Communications, n°88, pp. 83-91.
Notes
[1] Herbert Marcuse (Marcuse, 1963) soutient que l’essor du capitalisme a institué un principe de réalité utilitariste, qui constitue une forme de répression et d’instrumentalisation de la sexualité (située sous l’égide du principe de plaisir). Selon lui, les dépenses pulsionnelles et les socialités qu’occasionnent notamment les pratiques culturelles sont désormais soumises à des finalités productives.
[2] L’extimité est un concept élaboré par le psychanalyste Serge Tisseron. Le désir d’extimité renvoie au « processus par lequel des fragments du soi intime sont proposés au regard d’autrui afin d’être validés » (Tisseron, 2011, p. 84).
Pour citer l'article, Fugier Pascal, « Joëlle Deniot et Jacky Réault (dir.), Éros et Société. Vouloir vivre, vouloir jouir, vouloir mourir, vouloir tuer », dans revue ¿ Interrogations ?, N°17. L’approche biographique, janvier 2014 [en ligne],http://www.revue-interrogations.org/Joelle-Deniot-et-Jacky-Reault-dir (Consulté le 10 avril 2014).
______________
L ODYSSEE DU SUJET
DANS LES SCIENCES SOCIALES
CLIQUER SUR L IMAGE

De : cpalierne.arifts-ponants [mailto:cpalierne.arifts-ponants@arifts.fr]
Envoyé : lundi 2 mai 2016 18:21
À :
joelle.deniot@wanadoo.fr
Objet : Sélection Prix de l'Ecrit Social
2016
Bonjour,
Ce mail pour vous informer que
l'article d'Yves
GERIN, Les ratés du
gouvernement de la parole, Les Cahiers du
Lestamp, 4, 2015, a été retenu pour la sélection
2016 du Prix de l'Ecrit Social, catégorie
article. Rendez vous sur notre site pour en
savoir plus :
http://www.arifts.fr/index.php/accueil-pes.html
Vous pouvez me joindre au 0240840485 ou
0681252032
Cordialement.
Carole Palierne, coordinatrice du Prix
de l'Ecrit Social
________________
_______
Charles DREYFUS-PECHKOFF
à propos de J Réault et J
Deniot
(Eros et liberté)
(Préface à Eros e Liberté, Trois essais de
Sociologie et d'Histoire, Paris, Le Manuscrit
2014)
Erographie Démocratie
Démographie,
La toujours vivante
Grèce d'Eros de la passion historique, créatrice
et libératrice de
Jacky
Réault (titre de la rédaction du
site)
Pour l’historien et
sociologue, Jacky Réault, la passion d’amour en Eros
Eleutheros le libérateur,
attise l’ardeur grecque à faire cité belle
et libre. Elle invente cet adulte comptable face
à elle de la paideia du
jeune homme élu pour un idéal politique et
poïétique d’excellence. Cette présence
même d’Eros à la fois leur âme propre, et la
sublimation de la vie dans la beauté et dans
l’amour, unit l’animal politique et deux
personnes inégales, le temps d’un miracle.
Il faudra la fin de
la polis et
de longs cycles historiques pour qu’un mutuel
amour de l’homme et de la femme, accède en égal
à telle valorisation. Helléniste, il offre une
phénoménologie historique des variations de la
passion de vie et des formes d’Eros au travers
des pratiques sociales et politiques, des idées
et des formes entre beaux-arts et arts communs.
Sa toile de fond se résout au constat de
Castoriadis, les
mythes grecs sont simplement vrais, et en
cette ouverture : Eros,
ce concert
si singulier de la passion, d’amour, de la
pensée, d’art et l’âme
de la polis libre, voire de la démocratie…
est offert à tout humain en tout peuple, osant
ensemble Eleutheria, leur liberté.
L’éthique de la
tendresse tente d’inclure la procréation dans la
sexualité et non la sexualité dans la
procréation ; un devoir de perfection est alors
demandé dans une relation interpersonnelle.
Choix mutuel des conjoints versus pacte des
familles. Loi morale pour Kant tendant à
l’universalité : agis
de façon à traiter
en toi et en autrui la personne humaine comme
fin et non comme moyen.
Eros sublimé en tendresse ? Mais où est
passé son démonisme ? Cette double possibilité
de « l’érotisme » et de la tendresse ! La notion
d’amour surgit-elle comme une sublimation de la
sexualité ? Il semble que l’humanité l’invente
peu à peu sans qu’elle devienne une métamorphose
de la sexualité ni un avatar de la libido.
Charles Dreyfus-Pechkoff
(Préface à Eros e Liberté, Trois essais de
Sociologie et d'Histoire, Paris, Le Manuscrit
2014)
Eros à l'oeuvre
de
Joëlle-Andrée
Deniot
Passion créatrice et instinct de vie au
risque de l'art
(sous-titre de la rédaction)
Eros, pour
Joëlle-Andrée Deniot, c’est toujours cet élément
archaïque aux frontières du langage humain, de
la vie psychique volontaire et dont les
débordements provoquent angoisse, extase et
ritualité défensive. Cette étude nous place dans
une conception contemporaine. Du projet initial
de replacer dans une éventuelle logique
signifiante, dans une problématique unifiée, les
premières impressions, les premières images
associées au thème d’Eros et Société,
elle nous entraîne dans une socio-anthropologie
de l’art. Sous le prisme explicité d’une topique
du désirer-voir,
toute une gamme des formes visuelles de
l’esthétique d’Eros nous est contée. Porter
notre regard sur cette origine, ce jadis à
jamais perdu, ce manque à être que l’image
cherche à combler, en constitue le fil d’Ariane.
Dans cette démarche partant d’une intuition
personnelle séminale pour remonter vers une
analyse méthodique des figures culturelles
disponibles, rémanentes d’Eros dans les
beaux-arts, une foison pertinente de
télescopages d’œuvres se dessine. Nous sommes
entraînés dans un parcours commenté de
représentations où le corps sexué est un corps
séparé, que ce soit une sculpture antique,
l’œuvre de Camille Claudel ou encore un film
d’Ingmar Bergman. Un cheminement singulier dont
on retrouve l’esprit dans son approche
concernant les chansons et la gestuelle des
interprètes, entre l’image et le souffle.
Charles Dreyfus-Pechkoff
(Préface à Eros e Liberté, Trois essais de
Sociologie et d'Histoire, Paris, Le Manuscrit
2014)
__________________
Eros et société,
Vouloir
vivre vouloir jouir vouloir
mourir vouloir tuer
Dir J
Deniot J Réault avec L Delmaire,
Nantes Lestamp Edition -
Université de Picardie Jules
Verne Amiens Février 2012.
Une critique parue en janvier
2014 dans la revue en Ligne:
Interrogation, sous la plume de
Pascal
FUGIER,
Docteur en sociologie.
________
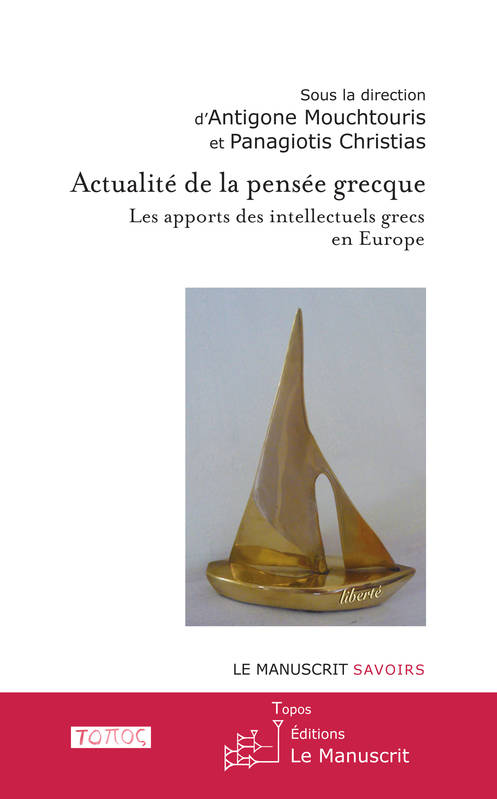
PREMIERES CRITIQUES
Francis
Farrugia,
Actualité de
la Pensée Grecque
Paris, France,
13 décembre
Bulletin de l'AISLF
Janvier 2012
PREMIERES
CRITIQUES cr du colloque.
Actualité de la Pensée Grecque
Paris, La Sorbonne, Amphi Durkheim,
France, 13 décembre
Ce colloque était organisé par le
laboratoire GEPECS et le CR14 Sociologie
de la connaissance de l’AISLF sous la direction
d’Antigone Mouchtouris (Université de Lorraine)
et de Panagiotis Christias
(Université
de Chypre).
"Une telle manifestation est avant tout
scientifique, il s’agit aussi d’un acte
politique par lequel il est rappelé que les
grands moments de l’histoire
intellectuelle européenne ont été créés par la
volonté propre d’hommes et de femmes. Octave
Merlier par exemple, directeur de l’Institut
Français d’Athènes, loua en 1945 le bateau
Mataroa qui amena en France deux cents
jeunes grecs qui fuyaient la guerre civile.
Parmi eux, certains ont marqué la
pensée française en participant activement aux
débats de leur époque.
Le colloque s’est déroulé sous les auspices de
l’Europe de la culture et du savoir. Nous avons
voulu rendu hommage à la générosité
intellectuelle de ces
témoins passeurs de la connaissance, soucieux de
l’esprit et de la justice."..
Pour le texte intégral de
Francis Farrugia
cliquer ici.
Concernant la participation d'un
membre du Lestamp dont l'article développé est
édité dans le livre
Actualité de la pensée grecque
P Christias, A Mouchtouris, Eds; Paris Le
Manuscrit 2014.
....
"Jacky Réault est revenu sur
les apports à l’histoire du marxisme
contemporain de la pensée de
Nikos Poulantzas,
peut-être celui qui fut le plus fébrile de tous,
vivant l’histoire du monde à travers son propre
corps. Certains intellectuels (et
notamment
Cornelius Castoriadis également
évoqué par JR*) ont
d’une manière ou d’une autre entretenu une
relation spéciale avec le marxisme et avec
l’antiquité grecque. Ce dernier capital les a
empêchés de sombrer dans le stalinisme et dans
la facilité intellectuelle."
*En italique Complément
de l'éditeur du site. Un autre auteur a
participé au livre tandis que certaines
communications n'ont pas été éditées.
Francis Farruggia
<francis.farrugia@wanadoo.fr>
Claude Javeau
des
impostures sociologiques,
Postface de
Jean-Marie Brohm,
Lormont, LE BORD DE L'EAU 2014
Chap
7 La
crise permanente de la
sociologie
A propos
de Joëlle-Andrée Deniot,
Edith
Piaf, la voix, le geste l'icône,
Esquisse anthropologique,
Préface de Jacky Réault.
Paris Lelivred'art 2012.
"Toute
autre est la
(la démarche)
de Joëlle-Andrée Deniot
lorsqu'elle s'en prend, si j'ose
dire, à Edith Piaf. Ici, c'est
l'admiratrice-auditrice qui
parle, dans une perspective
d'anthropologie phénoménologique
et non, ou à peine, historique.
A travers le corps, le visage,
les gestes, la voix de la
chanteuse, est proposée la
reconstitution d'un rapport
singulier au monde, au départ d'une visée
intersubjective. Et le préfacier
de ce livre foisonnant (et
parfois déroutant) de noter à
juste titre, en guise de
position intellectuelle: "Nul ne
clora ce livre sans avoir
éprouvé, ravi, étonné, furieux,
là où doit régner la séparation
positiviste, un noeud de liens,
où se résout un autre "religere"
de la connaissance. Liens entre
l'actrice réelle iconisée,
mythisée et ses peuples : entre
l'auteur, ses "objets" analysés
dans une compréhension qui les
restitue comme sujets ; entre
l'auteur et cet autre lieu
traité sans effroi ni
récupération, avec les peuples,
le populaire et ses icônes ;
entre l'écriture enfin,
l'écrivain et le référent1.
Au delà,
bien au-delà du compte-rendu
d'une histoire de vie édifiante
ou dénigrée, l'intention de
l'auteur est de confier au
"peuple", cet exclu des tableaux
statistiques et des camemberts,
des clés pour se retrouver en
tant qu'acteur multiple mais
concret de son propre
cheminement :"Mais dans un
présent sociétal si réducteur de
l'humain en choses sociales,
choses dominées, choses
massives, choses anatomiques ou
mécaniques, dans un présent
sociétal si obsédé de
gouvernance oligarchique, ne
faut-il pas tout de même laisser
au peuple quelque miroir
sublimant, quelque récit pour
adulte, d'affrontement au
destin"2
Loin de moi l'idée
que toute recherche digne de ce
nom doit ambitionner de rendre
la parole au "peuple". Mais au
moins doit-elle reposer sur un
dialogue assidu et réciproque
entre observé et observant,
narrateur et narrataire, dans le
respect d'une intersubjectivité
que, contrairement à ce qui
pourrait être prétendu, ne nie
pas l'intention scientifique."
(Claude Javeau Professeur
émérite à l'Université Libre de
Bruxelles.)
1- Jacky
Réault, Préface à
Joëlle-Andrée Deniot,
Edith
Piaf, la voix, le geste l'icône,
Esquisse anthropologique.
Paris Lelivred'art 2012. p.
20
2- Joëlle-Andrée Deniot, Op.cit.
p.57
_________
EROS
ET SOCIETE
Une
reconnaissance par le philosophe
franco-allemand, Arno MUNSTER
De : arno
munster [mailto:arnomunster@yahoo.fr]
Envoyé : dimanche 18 mars 2012 11:17
À : Jacky REAULT
<jacky.reault@wanadoo.fr>
Objet : Re : Prenez garde à Facebook et
autre big brother à patte de velour amical
Cher Jacky Réault,
Merci de votre
message d'avertissement concernant Facebook!
Je profite de
l'occasion pour vous accuser, hélàs, avec un
grand retard (mais j'étais très pris ces
dernières semaines avec des voyages et des
colloques), réception des actes du colloque
nantais "Eros et Société"(L'été de
Lestamp), un volume bien réussi dont
j'ai déjà lu, avec beaucoup d'intérêt et de
satisfaction, un certain nombre de
contributions, entre autres, celle de
Clélia Van Lerberghe sur
Jan Patocka et celle de Josef
Schovanec sur "Heidegger ou l'éros de
l'être". Merci aussi d'avoir
publié "en bonne place" ma contribution sur
Herbert Marcuse.
En vous souhaitant
encore beaucoup de succès, dans la continuation
de cette voie ...
très cordialement (v
bous eet à Joëlle Deniot)!
Arno Munster.
_______________________________
Cinquantenaire de la mort
d'Edith Piaf -
Joëlle-Andrée Deniot, une
sociologie ouverte une
anthropologie profonde,
un livre, une plasticienne
révélée Mireille Petit-Choubrac,
une chanteuse et son
accordéoniste
(ailleurs dans ce site, livres,
articles, évènements)
Sociologie de la chanson et de
la voix
Cliquer
|



