|
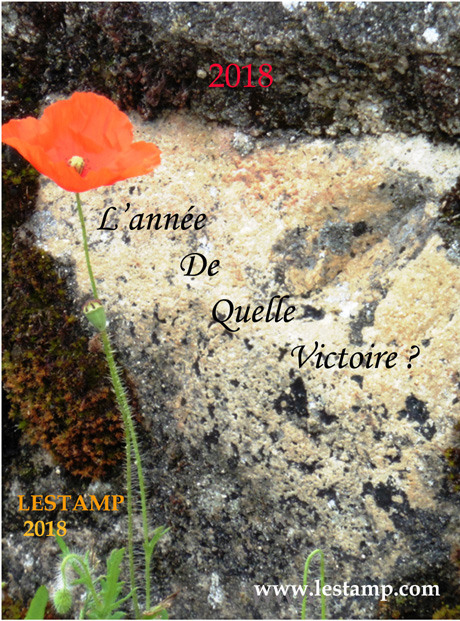 Chacun a
pu faire l’expérience dans une grande
surface du phénomène de file d’attente
qui se crée brutalement lorsqu’un
produit sans référence oblige la
caissière à faire appel à l’un de ses
collègues pour obtenir les
renseignements adéquats. Dans un premier
temps, elle tente de joindre son
collègue sur son poste. Il est rare que
celui-ci réponde immédiatement à ses
sollicitations. La caissière doit
alors manifester d’une façon quelconque
aux clients qui attendent sa sympathie.
Lorsque son collègue daigne enfin
répondre, son attitude change
immédiatement et elle adopte un ton
courtois mais ferme pour exposer le
problème et faire pression. Quelques
longues minutes peuvent encore s’écouler
pendant lesquelles la caissière doit
manifester à nouveau sa sympathie aux
clients jusqu’à ce que son collègue -
masculin le plus souvent – arrive avec
une étiquette ou tout autre symbole
visible de la référence demandée et
dénoue la situation en jouant de son
avantage. Chacun a
pu faire l’expérience dans une grande
surface du phénomène de file d’attente
qui se crée brutalement lorsqu’un
produit sans référence oblige la
caissière à faire appel à l’un de ses
collègues pour obtenir les
renseignements adéquats. Dans un premier
temps, elle tente de joindre son
collègue sur son poste. Il est rare que
celui-ci réponde immédiatement à ses
sollicitations. La caissière doit
alors manifester d’une façon quelconque
aux clients qui attendent sa sympathie.
Lorsque son collègue daigne enfin
répondre, son attitude change
immédiatement et elle adopte un ton
courtois mais ferme pour exposer le
problème et faire pression. Quelques
longues minutes peuvent encore s’écouler
pendant lesquelles la caissière doit
manifester à nouveau sa sympathie aux
clients jusqu’à ce que son collègue -
masculin le plus souvent – arrive avec
une étiquette ou tout autre symbole
visible de la référence demandée et
dénoue la situation en jouant de son
avantage.
L’analyse sociologique d’une telle
situation a un spectre relativement
large. Elle concerne évidemment les
conditions de travail. Un phénomène de
file d’attente sera d’autant plus
éprouvant pour la caissière qu’il se
déroulera à une heure de pointe
provoquant l’agacement des clients. La
situation dépend également du niveau
d’organisation de l’entreprise. Les
salariés présents dans les rayons
peuvent cumuler en effet plusieurs
tâches et devoir arbitrer entre elles.
Ce phénomène concerne également les
comportements liés à l’étiquetage. C’est
un problème complexe qui varie selon les
secteurs de la grande distribution, les
gammes de produit, leur niveau de
renouvellement mais aussi les
comportements de la clientèle qui
n’hésite pas soit à arracher les
étiquettes soit à les échanger.
Mais
au-delà de tous ces aspects, les
manières de se comporter des différents
protagonistes et de jouer leur partition
ont un rapport avec ce domaine des
relations sociales aux frontières un peu
floues que l’on nomme l’éthique ou la
morale.
De fait, pour apprécier si le temps
d’attente à une caisse est anormalement
long, il faut pouvoir définir ce que
« devrait » être le comportement des uns
et des autres dans un tel contexte.
C’est une des manières très indirectes
d’aborder le rapport entre éthique
sociale et compétitivité des
entreprises. Il n’est pas certain que le
sociologue puisse apporter une réponse
satisfaisante sur le terrain de la
compétitivité car ce qui l’intéresse
d’abord c’est d’apprécier si le
« dérèglement » qu’il observe relève ou
non d’une situation anomique
c’est-à-dire d’une situation où la
solidarité fait défaut. Mais, on peut
attendre cependant du sociologue qu’il
éclaircisse les logiques sociales à
l’œuvre dans les situations les plus
ordinaires de la vie quotidienne et
qu’il puisse tracer une frontière un peu
précise entre ce qui relève du « devoir
social » et ce qui y échappe. C’est ce
que nous tenterons faire dans cette
communication.
Impératif
catégorique et obligation sociale
La
plupart des comportements observables
dans la vie quotidienne relèvent de ce
que le sociologues nomment des ethos.
Chez les sociologues classiques, cette
notion est employée conformément à son
étymologie
et désigne le plus souvent les manières
habituelles de « se comporter » dans un
contexte social donné. Ces ethos forment
des gammes disponibles de pratiques en
lien avec les situations de la vie
quotidienne que chacun peut non
seulement mobiliser mais dont il peut
apprécier après coup la justesse par une
sorte de variation imaginaire entre ce
qu’il a fait et ce qu’il aurait dû
faire.
Le
sourire de la caissière et les paroles
d’apaisement constituent une gamme de
comportements qui s’imposent dans un
contexte précis d’interactions entre
individus où toute attitude laissant
entrevoir une forme d’indifférence
serait considérée comme répréhensible et
pourrait conduire à des réactions
d’hostilité. En manifestant ainsi sa
compassion aux clients lorsqu’il advient
un problème de file d’attente, les
caissières agissent-elles moralement ?
Si l’on
s’en tient aux apparences et aux
mimiques, il ne fait pas de doute qu’en
manifestant sa compréhension aux clients
tout en exerçant une pression amicale
sur son collège, la caissière adopte le
comportement qui convient à la situation
c’est-à-dire qu’elle a une « bonne
réaction ». Mais cela ne signifie pas
pour autant que ce comportement soit
moral car la notion d’éthique ne se
laisse pas circonscrire aussi aisément.
Le comportement de la caissière pourrait
être simplement la réponse à une forme
de stimulus ou l’application intéressée
de consignes.
Pour isoler les pratiques relevant d’une
règle morale des pratiques relevant de
simples règles utilitaires ou pratiques,
le sociologue Emile Durkheim écrit que
nous avons besoin de ce qu’il nomme un
« réactif »
c’est-à-dire d’un critère clair qui
puisse isoler les faits moraux de
l’ensemble des faits sociaux qui
constituent la trame de l’existence
quotidienne. Ce « réactif », Durkheim va
le trouver chez Kant.
Il est
en fait très difficile de comprendre la
position des sociologues classiques sur
l’éthique en particulier celle de Weber
ou de Durkheim si on ne fait pas
référence à ce qui constitue à la fin du
19e siècle la pensée
dominante en matière d’anthropologie :
le kantisme. Comme Kant, Durkheim
cherche à rendre compte en quelque sorte
d’une « nécessité » des actions
sociales qui ne soient pas soumis aux
contingences et à l’arbitraire, et qui
puissent faire l’objet d’une science
possible qu’il nommera la sociologie.
C’est la morale qui chez l’un comme chez
l’autre fournit l’ossature pour élaborer
une théorie de l’agir en société. Pour
Kant, l’agir humain ne saurait en effet
obéir aux mêmes lois que celles qui
commandent à la nature. Il faut ainsi
leur trouver un fondement : « chacun
doit reconnaître qu’une loi si elle doit
valoir d’un point de vue moral,
c’est-à-dire comme fondement d’une
obligation, doit être assortie d’une
nécessité absolue ; (…) par conséquent
que le fondement de l’obligation ne doit
pas être cherché ici dans la nature
de l’homme, ou dans les circonstances où
il est placé en ce monde, mais
seulement a priori dans des
concepts de la pure raison ».
Pour
reprendre notre exemple, il semble
évident que le comportement de la
caissière ne relèverait aucunement de
l’éthique s’il était l’expression d’une
sorte de propension naturelle au devoir
ou encore une réponse à un stimulus. Il
ne le serait pas également si c’était
uniquement sa position de salariée et
l’intérêt qui s’y rattache qui
l’obligeait en quelque sorte à
satisfaire ainsi la clientèle. Pour
Kant une action qui se conformerait
seulement à l’intérêt bien compris ne
saurait produire sur le long terme de
« bonnes pratiques ».
De l’épicier avisé qui, sur un marché
hautement concurrentiel, abandonne le
marchandage pour adopter une politique
de prix unique, Kant écrit « on est donc
honnêtement servi chez lui ;
pourtant c’est loin d’être assez pour
que l’on puisse croire que le marchand a
agi par devoir et par principe
d’honnêteté; son intérêt l’exigeait ».
La
morale exige que l’on agisse par
devoir plutôt qu’en se conformant à
un principe utilitariste c’est ce
que Kant nomme l’impératif
catégorique : « agis de telle sorte
que tu traites l’humanité aussi bien
dans ta propre personne que dans la
personne de tout autre, toujours en même
temps comme une fin, jamais comme un
moyen ».
C’est en rompant avec sa situation
particulière de caissière et en
percevant l’humanité de ce qui lui est
donné à l’instant comme cliente que la
caissière agit par devoir. En
faisant cela, la caissière révèle dans
le même temps sa propre humanité
c’est-à-dire sa capacité à se déterminer
librement sans céder par exemple à la
fatigue ou à l’irritation provoquée par
une cliente qui aurait sans doute pu
choisir un produit mieux référencé.
Agir par devoir, c’est toujours d’une
certaine manière dépasser les
contingences du moment et faire violence
à son conditionnement.
Durkheim
trouve dans cette notion d’impératif
catégorique, le concept dont il a
besoin pour isoler et différencier les
faits moraux des autres faits sociaux.
Il existe un grand nombre de pratiques
sociales qui se conforment à des
règles : les techniques de sondage, la
cuisine, le jardinage, etc. Ces
pratiques le plus souvent utilitaires
sont compréhensibles puisqu’il est
toujours possible de rapporter le
résultat à l’acte qui les a engendrées
mais elles n’offrent guère d’intérêt au
niveau d’une sociologie morale. Ces
actions participent à ce qu’il
conviendrait de nommer un «devoir
faire » plutôt qu’à un « devoir être ».
Le non respect des règles élémentaires
dans un sondage entraîne le plus souvent
des biais statistiques qui rendent
difficiles toute estimation fiable.
Cette sanction du non respect des règles
élémentaires de la statistique est
souvent une conséquence analytique des
moyens déployés (liste non exhaustive,
non respect des quotas par les
enquêteurs, etc.). Il n’en va pas de
même dans le domaine moral comme le
souligne Durkheim.
Il n’existe aucun lien analytique entre
la forme de la sanction et l’acte
lui-même. Le fait de tuer en temps de
guerre et le fait de tuer en temps de
paix n’expose pas aux mêmes
conséquences. Dans le premier cas, le
meurtre est autorisé dans un cadre
social donné et peut conduire à des
honneurs, dans le second cas il est
totalement interdit et expose à des
sanctions lourdes. Cet exemple révèle
cependant d’une manière évidente ce qui
peut séparer une « sociologie morale »
d’une « métaphysique mœurs ».
A la différence de Kant pour lequel le
devoir est immanent à l’homme en tant
qu’être raisonnable fini, chez Durkheim
l’obligation morale procède de la
société en tant que lieu où l’on doit
vivre tous ensemble dans une forme de
respect : « La morale commence donc là
où commence la vie en groupe, parce que
c’est là seulement que le dévouement et
le désintéressement prennent un sens ».
Bonheur
éthique et souffrance morale
L’éthique telle qu’elle est esquissée
par Durkheim donne un ancrage – les
contraintes de la vie en société - sans
lequel l’impératif catégorique kantien
reste suspendu dans le ciel de la
philosophie et n’offre de fait aucune
garantie de réciprocité sociale : « Et
bien que l’être raisonnable ne puisse
pas escompter que, quand bien même il
obéirait scrupuleusement à cette maxime
en ce qui le concerne, il s’ensuivrait
que les autres êtres raisonnables lui
seraient également fidèles ».
Cette absence de garantie dans la
réciprocité des actions tient chez Kant
à la nature duale de l’homme : être de
raison mais également être de nature
menée par ses désirs et ses
inclinations. Ce dualisme n’existe pas
chez Durkheim pour lequel l’homme est
toujours un être social dont les
penchants loin de résulter d’un état de
nature sont le produit d’un processus de
socialisation et d’éducation.
En
déplaçant la focale de l’être de raison
à l’être socialisé, tout en conservant
l’exigence d’un fondement a priori des
lois morales, Durkheim se donne les
moyens de penser l’historicité des
valeurs sans tomber dans le relativisme
mais également de décliner la morale en
fonction des différents lieux de vie :
la famille, l’entreprise, la société
civile, etc. « Chaque société, écrit
Durkheim, a en gros la morale qu’il lui
faut »
.
L’attitude de la caissière ne peut être
décrite comme morale que dans un monde
social où il y a des clientes, des
articles référencés et des files
d’attente et où l’on apprend par le
processus de socialisation à s’y
orienter et à s’y comporter de la
manière la plus adéquate possible. Le
social est moral parce qu’il est
intelligible par tout un chacun. C’est
ce qui fonde la réciprocité des actions
morales. Le client qui fait l’effort
d’écarter un produit sans référence au
profit d’une marchandise étiquetée
accomplit une action qui reste sans
signification si on ne la rapporte à
l’ensemble du « jeu social » qui
caractérise cet univers particulier que
l’on nomme une grande surface. En
prenant le produit référencé, il
anticipe ainsi sans en avoir conscience
le plus souvent l’ensemble des coups
liés à ce jeu particulier, et les
désagréments qui en résulteront pour
l’ensemble des participants y compris
lui-même.
Il fait ainsi ce qu’il doit faire.
Pour
Durkheim cependant le devoir comme
obligation n’épuise pas le champ de la
morale. La réalisation du devoir
entraîne également une certaine
satisfaction difficile à définir :
« nous éprouvons un plaisir suis
generis à faire notre devoir, parce
qu’il est notre devoir ».
Comment expliquer sinon la répétition
dans le temps d’actions morales qui
impliquent une forte contrainte sur
soi ? Le don du sang est un fait moral
qui reste incompréhensible le plus
souvent aux non donneurs qui n’y voient
qu’une somme de désagréments.
Les donneurs ont eux-mêmes le plus
souvent du mal à expliquer ce qui les a
motivés. Le premier don se fait le plus
souvent au sein d’un groupe : en
famille, au lycée, au service national,
dans l’entreprise, etc. Dans un tel
contexte, il n’y a le plus souvent aucun
moyen de se soustraire à ce qui
constitue un véritable impératif pour
signifier son appartenance au groupe.
Chez les donneurs « spontanés », c’est
aussi sentiment d’une obligation
vis-à-vis de la communauté des vivants
qui revient le plus souvent dans les
propos des donneurs : « on m’a donné la
vie et je me dois de la rendre à mon
tour». D’ailleurs, il est extrêmement
symptomatique de constater que les
mouvements sectaires comme les témoins
de Jéhovah réprouvent le don du sang et
interdisent à leurs membres toute
transfusion sanguine. Mais au-delà de
cet impératif moral, il existe un
sentiment de plénitude attaché au don.
Interrogés à leur sortie du camion ou
des centres de transfusion, les donneurs
avouent avec une forte régularité « se
sentir bien » sans pouvoir analyser plus
avant cette sensation. A l’inverse,
lorsqu’un donneur se présente et que son
don est refusé, cette mise à l’écart
suscite une véritable blessure morale
liée à un sentiment d’injustice. En
refusant son don, le donneur se trouve
brutalement mis à l’écart de cette
communauté à laquelle il se donne. La
prévention du Sida a amené depuis les
années quatre-vingt à exclure un certain
nombre de personnes du don du sang soit
en raison de leurs pratiques sexuelles
soit parce qu’elles avaient été
transfusées. Cette exclusion se fait le
plus souvent d’une manière « brutale »,
sans véritable explication, après un
interrogatoire qui a été très longtemps
« humiliant » dans sa forme même.
Tant que
l’on ne perçoit pas les états psychiques
de bonheur ou de blessure morale qui y
sont associés, les faits moraux peuvent
être aisément confondus avec d’autres
faits sociaux par un spectateur
extérieur. Ces critères sont évidemment
complexes à mettre en œuvre sur un plan
empirique, et tout particulièrement
l’aspect positif que constitue le
« bonheur » lié à l’accomplissement du
devoir. Le jardinier qui réussit son
plan de tomates, le sondeur qui évite
les biais méthodologiques, l’escroc qui
réussit son coup, le tartuffe qui se
conforme à la morale éprouvent tous à
des degrés divers une satisfaction ou un
plaisir. Mais l’échec dans tous ces
domaines n’implique aucune blessure ou
souffrance morale spécifique tout juste
un fort mécontentement.
Ce
bonheur ou cette souffrance liée au fait
moral se rencontre fréquemment dans le
milieu industriel dès lors que l’on
reste attentif aux communautés de vie.
Le film les « Temps modernes » de
Charlie Chaplin s’attache à montrer le
travail à la chaîne comme un travail
déshumanisé. On pourrait dire à l’image
du « non donneur » que nous décrivions
précédemment que Chaplin ne perçoit dans
l’enchaînement des gestes que la somme
des contraintes et des désagréments. Une
longue tradition qui remonte à Adam
Smith nous a habitué à voir dans la
spécialisation des gestes de l’ouvrier
une perte d’humanité.
Dans les années soixante-dix, j’étais à
l’Inspection du travail. L’organisation
du travail dominante sur les entreprises
de mon secteur étaient celles du travail
à la chaîne. L’essentiel de la
production était effectuée par des
femmes qui restaient huit heures debout
à leur poste où elles répétaient
inlassablement les mêmes gestes.
En tête de ligne se trouvaient le plus
souvent des hommes. Le système de
recrutement reposait essentiellement une
forme de sélection « morale ». Dans la
plupart de ces entreprises, il existait
une forme de prime au rendement qui
soudaient les équipes sur les chaînes.
Les débutantes étaient mis à des postes
où les gestes et leur enchaînement
étaient encore relativement simples pour
ne pas faire perdre de temps au reste de
l’équipe. Les plus expérimentés et les
plus anciennes ne manquaient pourtant
pas de les mettre à l’épreuve. Elles
mettaient la pression sur les nouvelles
arrivantes. Les plus fortes moralement
s’en tiraient mais les plus fragiles
démissionnaient souvent avec fracas.
J’ai vu ainsi des jeunes femmes
quittaient leur poste de travail en
larmes et rester prostrée.
Les
débutantes qui produisaient un boîte
défectueuse ou faisaient tomber une
pièce n’étaient pas réprimandées parce
qu’elles avaient « mal » effectué leur
tâche mais parce qu’elles avaient fait
perdre du temps à l’équipe et s’étaient
ainsi « mal » comportées. L’équipe était
le lieu de production d’un véritable
morale professionnelle mais également
sociale basée sur ce que Durkheim a
nommé la solidarité organique.
En même temps, cette solidarité figeait
le système des relations
professionnelles au sein des
entreprises. Les discriminations
héritées du mode de gestion paternaliste
où les hommes étaient systématiquement
avantagées au niveau de la promotion aux
postes de maîtrise se maintenaient alors
même que les nouvelles directions des
ressources humaines encourageaient une
certaine mixité. Les jeunes femmes qui
voulaient accéder à la maîtrise étaient
considérées comme des « traîtres » ou
des « favorites ». Les pires calomnies
couraient sur leur compte et elles
étaient le plus souvent ouvertement
accusées d’avoir bénéficié d’une
« promotion canapé ». Mais ces
collectifs soudés étaient à l’origine
d’un syndicalisme dynamique et
revendicatif. Pour pasticher le slogan
des «bleus « on vit ensemble, on meurt
ensemble », ces femmes voulaient « vivre
ensemble et s’élever ensemble ».
Il est
difficile de comprendre leur sacrifice,
leur mépris pour les « favorites » mais
également pour toute forme de « tirage
au flanc » si on ne perçoit pas que
c’est cet effort qu’elles
accomplissaient qui les grandissaient.
Beaucoup faisaient ainsi des kilomètres
en mobylette par tous les temps et quel
que soit leur état de santé pour venir
faire leur journée. Si leur salaire
était un peu plus élevé que le SMIC, il
ne leur permettait guère de se
distinguer matériellement de celles qui
vivaient des aides sociales et des
allocations familiales. Mais ces femmes
avaient comme elles le répétaient
souvent « leur fierté pour elle ».
Ethique
impérative et éthique des biens
L’exemple du don du sang et l’exemple de
l’ethos fordien illustrent certains
paradoxes intrinsèques à l’éthique
kantienne ou à la morale durkheimienne.
L’impératif catégorique ou le devoir
moral peut non seulement ne pas
coïncider avec des objectifs de santé
publique ou une évolution souhaitable du
monde qui nous entoure mais il ne
s’évalue pas à l’aune de ses
conséquences pratiques. L’idée de faire
dépendre la valeur morale de la volonté
du niveau auquel elle peut contribuer à
« maintenir » ou à « favoriser » un
certain bien être social n’a absolument
rien d’éthique au sens kantien. C’est
même un véritable contre-sens
que commettent souvent ceux qui
sous-couvert d’un affichage « éthique »
plaident dans le sens qui convient à
leurs intérêts du moment. Ce qui donne
à l’ouvrière fordienne sa « fierté »
c’est d’abord la coupure qu’elle
institue avec un ordre temporel ou
économique qui aurait pu l’inciter soit
à rester chez elle en bénéficiant des
aides publiques soit à accepter la
promotion individuelle. Car l’éthique
n’est pas sans lien comme le montre
Durkheim avec le sacré :
l’être moral est un être séparé.
Cette
coupure qui autonomise le comportement
moral et lui donne sa prégnance dans
l’agir le rend dans le même temps peu
réactif aux contingences historiques.
Cette autonomie des ethos par rapport à
l’historicité conduit à ce que Pierre
Bourdieu a nommé des effets d’hysteresis
illustrée par le
comportement de Don Quichotte qui se bat
contre des moulins à vent au nom d’une
éthique chevaleresque. Comme le montre
finement Max Scheler l’éthique kantienne
n’est pas une « éthique des biens » ou
une « éthique des buts » c’est-à-dire
une morale qui viserait à favoriser un
certain état du monde comme une
meilleure répartition des richesses ou
un certain niveau de civilisation
. Un telle éthique
non seulement s’anéantirait en se
relativisant mais perdrait toute
capacité critique liée à l’autonomie de
la volonté : « Devant n’importe quel
aspect de ce monde, nous ne pourrions
que nous incliner et accepter tout
simplement n’importe quelle tendance
évolutive qu’il peut déceler ».
Le fait
de lier comme le font aujourd’hui un
certain nombres d’entreprises l’éthique
à un certain état du monde souhaitable
- diversité,
sécurité alimentaire, compétitivité,
etc. - montre à l’évidence que les
morales ainsi prônée sont largement
instrumentales. Parmi les expressions
les plus achevées de cette éthique des
biens, on trouve les « guides de bonnes
pratiques » qui fleurissent un peu
partout à l’initiative des entreprises
et qui assurent non seulement que les
biens ou les services répondent aux
différentes normes de sécurité en
vigueur mais que les salariés ont les
« bons » comportements face à ces
normes, et enfin que les dirigeants en
adoptant ces normes oeuvrent pour
l’intérêt de tous. Ces éthiques
instrumentales ne visent le plus souvent
qu’à éviter les procès aux grandes
firmes en dégageant au maximum leurs
responsabilités dans une société où la
juridicisation s’étend progressivement à
tous les domaines de la vie sociale.
Mais la
confusion entre éthique impérative et
éthique des biens trouve également son
fondement dans une illusion du sens
commun qui tend à ne voir dans les
comportements moraux que le respect des
règles c’est-à-dire à inverser le
processus de construction des faits
moraux qui va des pratiques sociales aux
modèles de comportement.
Cette illusion a été analysée à maintes
reprises par Wittgenstein pour lequel
« suivre une règle » est d’abord un
abus de langage : « Est-ce que ce que
nous appelons « suivre une règle » est
quelque chose qu’un seul homme pourrait
faire une seule fois dans sa vie ? Et
il s’agit là d’une remarque concernant
la grammaire de l’expression « suivre
une règle ». Il n’est pas possible
qu’une seule fois un seul homme ait
suivi une règle. Il n’est pas possibles
qu’une seule fois une seule
communication ait été faite, un seul
ordre donné, ou compris, etc. Suivre une
règle, communiquer quelque chose, donner
un ordre, joueur une partie d’échec,
sont des coutumes (pratiques,
institutions) ».
La
plupart des gestes que l’on accomplit
dans les interactions quotidiennes
suppose que l’autre se comporte par
« devoir ». Si tel n’était pas le cas,
la vie en société deviendrait
impossible : il faudrait recompter sa
monnaie, vérifier que le journal que
l’on vous vend n’est pas celui de la
veille, que les carnets de métro
comportent bien 10 tickets, etc. Les
conventions libres entre individus n’ont
de chance d’être respectés que si elles
correspondent chez les individus à un
« devoir social ». Toute charte ou toute
réglementation présuppose toujours les
conditions de son application c’est
ainsi l’on peut interpréter la formule
« nul n’est censé ignorer la loi ».
Or, tout
se passe avec les « codes de bonne
conduite » comme si le salarié
n’adoptait pas spontanément dans leur
travail et dans leur relation aux autres
un certain sens du « devoir » mais au
contraire que les « bons gestes »
résultaient du suivi des règles édictées
par les « managers ». On se trouve dans
une situation que Bateson a théorisé
sous le terme de « double contrainte ».
Le salarié doit pour ne pas être
sanctionné faire semblant de se
conformer à un code de conduite
extrêmement contraint et limité alors
que spontanément son « ethos » lui
permettrait d’adopter le « bon geste »
aux différentes situations sociales qui
s’offrent à lui. Ces « codes de bonne
conduite » ou ces « bibles » peuvent
lorsqu’ils sont appliqués à la lettre et
sans souplesse produire les mêmes effets
que la « double contrainte » et conduire
aussi bien à des comportements
« humoristiques » jouant des paradoxes
qu’ à des pathologies sociales.
Pour
mettre en évidence certains aspects de
ce phénomène, l’on peut comparer ce qui
se passe dans une supérette de village
et dans une chaîne de la grande
distribution. Les caissières dans une
supérette de village ne sont pas
contraintes par un code et beaucoup de
leurs comportements sont spontanées.
Elles se déplacent en rayon pour aller
voir le prix des articles, prennent le
temps de bavarder avec les vieilles
personnes et les aident à remplir les
chèques quand elles ont oublié leurs
lunettes. A l’inverse, si l’on se
déplace vers les grands centres urbains,
les caissières de la grande distribution
perdent toute spontanéité dans les
relations sociales pour appliquer un
code de bonne conduite que les
directions leur imposent et que l’on
appelle le « cycle soleil ». Celui-ci
consiste à enchaîner en présence du
client les comportement suivant :
« bonjour » -« regard »-« sourire »-« au
revoir » et « phrase de conclusion », et
ce dans toutes les circonstances même
les moins appropriées. Ces nouvelles
pratiques engendrent ainsi des
situations burlesques
dont chacun a pu être témoin. Si
m’adressant à un salarié en rayon je lui
dis « Pardon pourriez-vous me dire où se
trouve la tapenade ? » je vais aussitôt
enclencher le « cycle soleil » avec un
« Bonjour Monsieur » puis sourire et
attente. Je suis alors obligé pour
répondre à cette nouvelle situation de
dire « Bonjour » et de reformuler ma
question. Il est évident que le ou la
salariée peut jouer de cette situation
et détourner la règle instituée en une
sorte de pastiche d’interaction.
A la
différence des systèmes traditionnels où
les contrôles portaient uniquement sur
le produit fini, ces systèmes dits de
« bonnes conduites » mettent en place un
contrôle généralisé des faits et gestes
des salariés. L’analyse sociologique
des comportement liés à la mise en place
de ces « codes de bonnes conduites »
peut révéler selon les contextes un
contournement de ses règles dont
l’application pourrait conduire à un
théâtre de l’absurde ou à un stress mal
supporté par les salariés. Les salariés
doivent aujourd’hui arbitrer
continuellement entre leur éthique
professionnelle qui leur commande de
déployer leur savoir-faire et un
ensemble de tâches administratives qui
tel le tonneau des danaïdes ne semble
jamais avoir de fin, et que faute de
temps ou de moyens adaptés on remet à
plus tard s’exposant par là-même à des
contrôles inopinés et à des sanctions.
Il en va ainsi dans les restaurants
scolaires, où les cuisiniers n’ont plus
seulement à préparer les plats et à
respecter les règles d’hygiène
élémentaires mais également à redoubler
le moindre de leur geste par une
littérature où ils indiquent ce qu’ils
font (ex : température des chambres
froides, température de chaque produit
sorti du four, etc.). A ces formes
d’autocontrôle se rattachent des formes
de contrôle direct sur les pratiques des
autres salariés. C’est ainsi qu’à la
livraison de produits frais, les
salariés chargés de la réception doivent
monter dans les camions frigorifiques
pour vérifier la température. Mais c’est
s’engager dans un processus qui tel le
raisonnement ad infinitum annule la
règle qu’il prétend poser. La plupart
des salariés refusent de s’engager dans
un tel processus et se contentent de
faire confiance au conducteur car s’il
ne le faisait pas ce serait admettre
qu’il puisse ne pas accomplir son
devoir, et ce raisonnement pourrait
s’étendre à la personne qui l’a précédée
et ainsi de suite.
Ces
formes de contrôle et d’autocontrôle
sont renforcés par des audits et des
processus de surveillance. C’est ainsi
que ce sont multipliés les caméras de
vidéo-surveillance dans les ateliers, la
GPS pour suivre les conducteurs
routiers, le suivi informatique des
phases de fabrication, les « clients
mystères dans les grandes surfaces » et
parfois des systèmes d’écoute
téléphonique comme dans les centres
d’appel, etc. En faisant de chaque
salarié un suspect provisoire, ces
pratiques de management confèrent au
salarié le sentiment d’une faute
originelle qu’il doit sans cesse
combattre en apportant la preuve de sa
« bonne conduite » selon le slogan
« dire ce que vous faites, faire ce que
vous dites, et en apporter la preuve ».
La présomption d’innocence s’inverse
pour devenir une présomption du
culpabilité. Les collectifs de travail
trouvent le plus souvent spontanément
des parades à ces règles qui si on les
suivait à la lettre interdiraient toute
spontanéité, toute créativité mais aussi
gêneraient considérablement les tâches à
faire. Mais, là où les collectifs sont
fragiles parce que constitués de
salariés ayant des statuts différents
(CDI, CDD, salariés temporaires,
salariés à temps partiel), des
formations professionnelles plus ou
moins adéquates, dans un contexte
économique d’incertitude très élevé,
l’omniprésence de ces codes et de ces
contrôles peut conduire à de véritables
pathologies sociales : turn-over,
absentéisme, mais également tentatives
de suicide sur le lieu de travail.
Comme le
note Christophe Dejours, le suicide sur
le lieu de travail ou à proximité est un
phénomène cliniquement nouveau qui
remonte à la fin des années quatre-vingt
dix.
L’étude menée par l’inspection médicale
du travail en Basse-Normandie sur les
suicides des salariés sur leur lieu de
travail révèle que, dans près d’un cas
sur deux, ce suicide trouve une de ses
causes dans les conditions de travail et
s’apparente à ce que nous avons appelé
une « blessure morale » : « ce qui
paraît essentiel dans le passage à
l'acte est l'isolement de la personne
dans un système où il ne peut plus se
raccrocher, ni à son travail qu'il ne
maîtrise plus, ni à ses valeurs qui
sont battues en brèche. Il n'est
plus reconnu, il ne peut plus trouver
d'aide parmi les collègues de travail,
la hiérarchie devient indifférente sinon
hostile… la personne perd pied ».
La juste
mesure des rapports sociaux
Il
serait cependant maladroit de pas
chercher à comprendre sociologiquement
le développement récent de cette
abondance de codes et de chartes au
niveau des entreprises. Si les nouveaux
managers ressentent un tel besoin de
réglementer les pratiques de leurs
salariés et leurs relations avec leurs
partenaires c’est évidemment que tout ne
se passe pas conformément à ce qu’ils
souhaiteraient. Le rappel de 158000
véhicules Volvo en 2006 mais également
le rappel quasi quotidien par les
différentes firmes de produits
défectueux en Europe montrent que les
nouveaux processus de production basés
sur le « juste à temps » et l’assemblage
d’éléments produits aux quatre coins du
monde sont à l’origine de risques
industriels qui sont difficilement
solubles dans une société libérale
avancée où le système d’externalisation
et de sous-traitance en cascade est
devenu la règle. Même dans les domaines
où il est le plus avancé comme la
logistique, le contrôle des activités en
amont ou en aval – code barre,
standardisation des emballages,
informatisation des flux, etc. - se
heurte aux réalités des rapports de
force économiques et aux aléas de la vie
quotidienne –panne de camion, accidents
de toute sorte, etc. - qui font que les
entreprises ne peuvent jamais d’une
manière totalement optimale gérer leur
approvisionnement ou l’écoulement de
leur stock.
Une
partie du problème tient à ce que Marx a
identifié comme une contradiction au
sein du capitalisme entre une
organisation productive au sein des
entreprises qui peut toujours se régler
a priori et de manière relativement
optimum, et une organisation mondiale de
la production dont la régulation étant
soumise aux lois du marché et de la
concurrence ne se fait jamais qu’a
posteriori.
Il faut donc que les « crises » éclatent
pour que les pouvoirs publics ou les
industriels en prennent la mesure et
tentent d’y remédier. On pense
naturellement au réchauffement
climatique, au scandale de la « vache
folle », au marché du sang ou des
organes, aux différentes crises
financières, etc.
Une
autre partie du problème tient à ce que
cette contradiction entre comportements
réglés et prévisibles et comportements
non réglés dont on ne peut mesurer la
justesse qu’a posteriori existent
contrairement à l’analyse marxiste au
sein même de toute organisation du
travail. Dans notre exemple du départ,
le comportement de la caissière est
relativement prévisible car il se
déroule aux yeux de tous sur une
« scène » où chaque acteur est appelé à
jouer son rôle sans pouvoir reculer. Il
n’en va pas de même pour ce qui concerne
le collègue se trouvant en rayon. Si la
caissière occupe le devant de la scène,
lui se trouve dans les coulisses occupé
à quelque tâche. Ce collègue peut être
en train de renseigner un client, et
dans ce cas il se trouve dans la même
situation que la caissière. Il peut être
en pause ou en réunion avec son
« chef ». En l’appelant, la caissière
crée ce que Burt nomme un « trou
structural »
qui met le salarié à la croisée de deux
impératifs. Cette situation ne peut être
aisément résolue dans une perspective
kantienne car de quelque côté qu’il se
tourne le salarié risque de trahir un
impératif catégorique. Cette incertitude
est au fondement d’un certain pouvoir
d’arbitrage. La durée de la file
d’attente sera fonction de ce pouvoir.
Il pourra interrompre une conversation
déplaisante avec son « chef » pour voler
au secours de la caissière ou prolonger
un peu sa pause et amplifier la file
d’attente. Il existe certaines
entreprises qui pour résoudre ce genre
de conflit mettent en place des
« salariés » qu’on affuble de rollers
pour donner l’impression à la clientèle
d’une véritable célérité. Mais, à
l’image du sourire compatissant de la
caissière, les rollers n’ont qu’un sens
métaphorique, ils signifient simplement
que l’on fait le maximum pour diminuer
le temps d’attente.
Ce
pouvoir d’arbitrage, la caissière doit
en tenir compte. Pour limiter l’attente,
elle doit éviter de se montrer agressive
envers son collègue. Mais si la
situation se prolonge, il arrivera un
moment où l’on débouchera sur une crise,
c’est-à-dire une situation où la morale
est mise en défaut. S’il existe une
forme de solidarité obligée entre la
caissière et son client, la relation
entre la caissière et son collègue est
assortie d’une incertitude qui peut
conduire au conflit. La première
relation se déroule dans la zone du
devoir, par contre la seconde se déroule
dans la zone du pouvoir. Si le
comportement de la caissière est donc
facilement analysable dans le cadre de
la sociologie morale et de l’éthique
kantienne, il n’en va de même pour celle
du collègue. Pourtant, cette situation
soulève les questions les plus
intéressantes car elle subsume tous les
cas où il existe une asymétrie
situationnelle c’est-à-dire tous les cas
où un pouvoir entre en jeu, et on sait
que ces situations constituent un aspect
essentiel des relations sociales.
Les
relations asymétriques échappent-elles
au règne de la morale ? Il semble
évident que chez Kant, les relations de
pouvoir transformant les hommes en
moyens ne peuvent être qu’amorales. Chez
Durkheim,
les relations de pouvoir qui sont
circonscrites sociologiquement aux
relations d’autorité relèvent très
nettement de la sociologie morale.
L’obéissance et le commandement
impliquent un certain « devoir être »
social. Cependant pour Durkheim ce
« devoir être » social a disparu dans
les sociétés capitalistes où ne règnent
le plus souvent dans les rapports
employeurs/salariés que la force ce
qu’il dénomme le travail « contraint ».
Le droit du travail naissant à l’époque
de Durkheim a tout au long du 20ème
siècle préciser les contours du « devoir
moral » de l’employeur que l’on peut
étendre aisément à toute personne qui
détient un pouvoir. Traditionnellement,
c’est la notion d’abus de pouvoir qui
est utilisée par les juristes pour
interpréter les relations liées à la
subordination. C’est ainsi que jusqu’à
la loi de 1973 sur la cause réelle et
sérieuse du licenciement, les conseils
de prud’hommes ont dû apprécier si
l’employeur s’était comporté lors d’un
congédiement en « bon » patron
c’est-à-dire en n’abusant pas de son
pouvoir. L’étude de la jurisprudence sur
la notion d’abus de droit montre que les
juges prud’homaux acceptent comme un
sorte de principe de base qu’il existe
dans des situations aussi asymétriques
que celles du rapport employeur/salarié
une manière de « bien » ou de « mal » se
comporter. Ils adoptent ainsi sans le
savoir la position développée par Max
Scheler
pour lequel l’impératif moral peut se
décliner aussi bien sous la forme « tu
dois faire le bien » que sous celle
« tu ne dois pas faire le mal ».
L’analyse qui ressort de la
jurisprudence des tribunaux peut ainsi
être transposée à la situation opposant
la caissière à sa collègue. On peut
montrer qu’il s’agit d’un fait moral car
chacun a appris par la pratique ce que
ce serait de « mal » se comporter dans
un tel cas. La jurisprudence identifie
trois formes principales d’abus. Le
premier tient à l’intention de nuire. Le
salarié fait attendre la caissière pour
se venger parce qu’elle a repoussé ses
avances. La seconde tient à la mauvaise
foi. Le salarié fait attendre la
caissière en prétendant qu’il est
occupé. La troisième relève de la
légèreté blâmable. L’arbitrage auquel
procède le salarié entre ses impératifs
ne relève pas de la juste mesure qu’il
conviendrait d’adopter en pareil cas.
Ainsi plutôt que de répondre
immédiatement, il prolonge sa
conversation avec une jeune et jolie
cliente qui lui demande un
renseignement.
On est
libre d’imaginer d’autres exemples. A
chaque fois, on pourra déduire si le
salarié a ou non abusé de son
« pouvoir » sans pour autant que l’on
puisse fixer en ce domaine un catalogue
de règles à respecter tant les
configurations sont nombreuses. On
rejoint ici ce qui caractérise le fait
moral en opposition avec le fait
juridique : la morale est une raison
pratique que l’on ne peut enfermer dans
des règlements trop précis sous peine de
la dénaturer.
En fait,
comme le montre cet exemple les
relations de pouvoir n’échappent pas à
la « morale ». Les asymétries
situationnelles ne sont pas un frein au
comportement moral dès lors que celui
qui détient un pouvoir se comporte
« librement » au sens kantien
c’est-à-dire en ne tenant pas compte de
l’avantage immédiat qu’il peut tirer de
la situation et en s’élevant au-dessus
des préjugés de sa classe pour
considérer la situation du côté de la
scène et du côté des coulisse, et y
apporter la juste mesure.
Pour
conclure
La fin
du fordisme et l’apparition de nouveaux
modes de gestion du personnel basés sur
la flexibilité ont rompu les différents
pactes sociaux qui étaient fondés sur la
relation durable à l’entreprise pour
ouvrir une sorte de boîte de Pandore :
Comment être sûr que des salariés dont
le statut est souvent précaire et qui
sont peu ou pas du tout intégrés à
l’entreprise accomplissent au mieux les
tâches qu’on leur confie ? Dans les
premières phases du capitalisme où il
s’est agi d’intégrer des salariés issus
de la paysannerie attachée à une éthique
traditionnelle, la solution au problème
a été le fruit de ce que Georges
Canguilhem nomme l’illusion techniciste
qui consiste à « concevoir l’homme comme
une machine à embrayer correctement sur
d’autres machines ».
Ce système mettant entre parenthèse
l’homme et la question de l’éthique au
travail se concentrait uniquement sur
l’articulation entre un
« vivant simplifié» réduit à des
processus physiologiques et une
« machine » comme processus technique.
Le
nouveau management ne peut à la
différence du taylorisme mettre entre
parenthèse les problèmes d’éthique dans
un environnement où la judiciarisation
de la société est une véritable menace
pour les grandes firmes. L’auto-contrôle,
le contrôle interne et le contrôle
externe sont les moyens les plus
couramment utilisés pour aboutir à ce
résultat. Il s’agit d’une illusion
normative qui fait dépendre les
pratiques de l’application de normes.
L’idée que les bonnes pratiques
découleraient des règles inscrites dans
des chartes ou dans des règlements
assorties de sanctions à contre elle
l’évidence sociale que des notions telle
l’égalité de tous les citoyens dans
l’accès aux biens et aux services qui
est inscrite depuis longtemps au fronton
de nos édifices reste aujourd’hui encore
un droit à conquérir dans de nombreuses
sphères du social y compris
l’entreprise. Les bonnes pratiques
découlent tout simplement de leur usage
renouvelé au sein d’environnements
sociaux stables.
Un vrai
apprentissage c’est-à-dire un
apprentissage suffisamment long pour
qu’il puisse produire des effets
durables, le respect du salarié, une
organisation du travail qui facilite
l’émergence d’une conscience collective
sont encore les moyens les plus sûrs
d’obtenir du salarié qu’il accomplisse
sa tâche. C’est encore cette éthique qui
inspire nombre d’employeurs de petites
et de moyennes entreprises qui sont au
contact quotidien avec leurs salariés.
Comme l’explique un employeur d’une
entreprise de transport : « Moi je
traite mes salariés comme j’aimerais
être traité. Ils ont des camions assez
vastes et assez confortables pour
pouvoir y dormir, regarder la
télévision, se faire chauffer un plat,
et se mettre à leur aise. On se
débrouille toujours pour que les
tournées leur conviennent c’est-à-dire
leur permettent de gagner leur vie
honnêtement tout en étant rentables pour
l’entreprise. Ici on n’a pas besoin de
norme iso, car la qualité que j’assure
tous les jours à mes clients elle vient
du respect que je manifeste à mes
salariés. Si le salarié est respecté, il
vous respectera et ne vous enverra pas
balader le jour où vous aurez besoin de
lui demander un plus » (entretien avec
un directeur d’entreprise de la région
nantaise).
En
rupture et en continuité avec la
philosophie kantienne, la sociologie
classique a tenté de rendre compte des
actions sociales en remontant aux
raisons pratiques qui les inspirent.
C’est le projet même d’une anthropologie
c’est-à-dire celle d’une « connaissance
pragmatique » qui vise l’exploration de
ce que « l’homme, comme être agissant
par liberté, fait ou peut et doit faire
de lui-même ».
|



