|
|
 |
|
|
 |
| |
| |
|
 |
Corpographie-Edit.originale
intégrale |
| |
|
|
|
__________________
Evenements
Annonces Reportages |
|
____________________ |
| |
25, Boulevard Van Iseghem
44000 - NANTES |
Tél. :
Fax : |
02 40 74 63 35, 06 88 54 77 34
02 40 73 16 62 |
|
|
|
|
| |
>
Newsletter lestamp |
|
| |
www.sociologiecultures.com
Découvrez des
synthèses
portant sur des
thèmes de la
sociologie et du
développement des
cultures populaires,
de l'esthétique de
la chanson, des
connaissances
appliquées.
Des tribunes
s'engageant
sur le rapport de
l'anthropologie
fondamentale des
sociétés et des
politiques aux
sciences sociales,
des liens
vers des sites web
de référence. Si
vous voulez
les télécharger
en vous abonnant,
Lestamp-copyright.
cliquez ici. |
|
| |
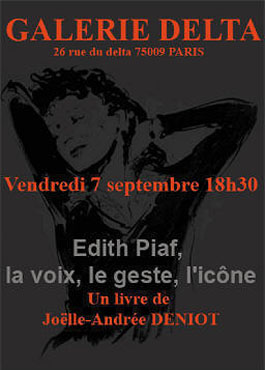 |
|
|
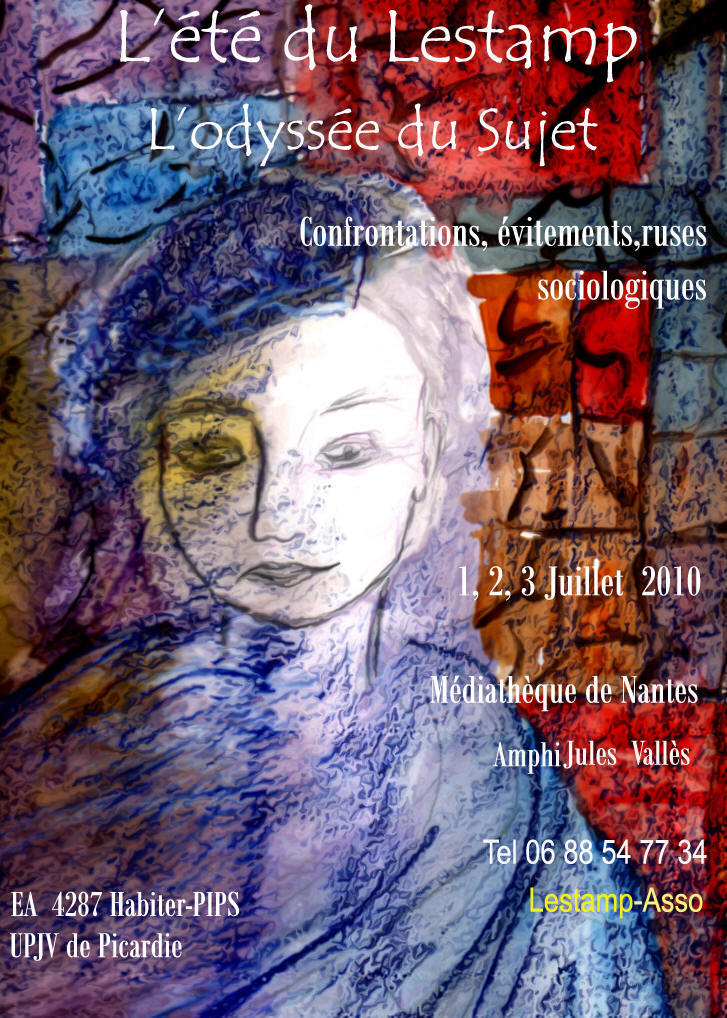 |
|
|
|
 |
|
|
 |

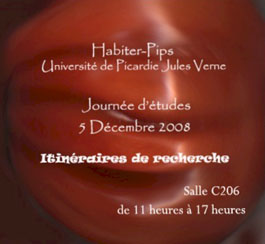


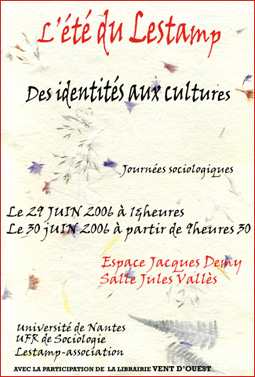 |
 |
|
|
|
|
 

Pour un
écosystème réel et virtuel des social
scientists et des sites ouverts à un
lieu commun des sciences sociales et à la
multiréférentialité
Revues en lignes,
-Pour
un lieu commun des sciences sociales
www.sociologie-cultures.com
-Mycelium
(Jean-Luc
Giraud, Laurent Danchin=,
Cliquer pour
découvrir les nouveautés
de septembre
2012
-Interrogations
http://www.revue-interrogations.org/actualite.php?ID=95li
Cliquez
sur l'image pour accéder au
film sur Youtube
Joëlle Deniot. Edith PIAF. La voix, le
geste, l'icône.
de
ambrosiette
(Jean Luc Giraud sur une prise de vue de
Léonard Delmaire

|
|
Tradition locale et marché global : le
travail de la céramique
dans les Pouilles au sud de l'Italie
|
|
|
Eugenio IMBRIANI
Università degli Studi di Lecce
Docente di Antropologia culturale Facoltà di Scienze
della formazione Dipartimento di Scienze sociali e
della comunicazione
Droits de
reproduction et de diffusion réservés ©
LESTAMP -
2005
Dépôt Légal Bibliothèque Nationale de France
N°20050127-4889
Dans
les Pouilles, le travail de l'argile et la production de
terre-cuite ont une histoire très longue: ceci dépend
fondamentalement de la présence de matière première dans le
sous-sol et de la facilité de son repérage et de son
extraction. Pendant des siècles, cette activité a intéressé
de manière particulière de nombreuses localités de la
région, du nord au sud de celle-ci, dans des zones qui l'ont
favorisée par leurs caractéristiques environnementales:
environnements dans lesquels il était facile de trouver
l'eau, indispensable soit dans les phases d'épuration de
l'argile, soit lors du modelage, ainsi que le combustible
naturel pour les fourneaux.
Les témoignages provenant des siècles passés, en particulier
relatifs aux XVIIIème et XIXème et à
une bonne partie du XXème, parlent de communautés
presque entièrement occupées dans le travail de la
terre-cuite. Cette forme d'artisanat se configurait, pour
ainsi dire, comme une "forme de vie" qui caractérisait
fortement la communauté même. Le repérage et l'extraction de
l'argile étaient essentiellement réservés aux paysans,
experts pour reconnaître les différentes qualités de terre,
et aux puisatiers. Des mines à ciel ouvert auraient pu être
exploitées intensivement, mais afin de ne pas dégrader la
superficie du terrain destinée à l'agriculture, les mineurs
s'aventuraient plutôt dans des galeries souterraines. Les
mottes de terre extraites étaient transportées sur des
charrettes et déchargées devant les ateliers, puis laissées
sécher et émiettées. Les fragments plus petits étaient
réduits en poudre avec un léger marteau de bois puis passés
au tamis, cela servait comme ajout à l'argile trop humide.
Les restes servaient à renforcer le crépis des parois
internes du four.
L'argile était donc laissée à décanter dans des bassines
pleines d'eau, puis battue avec les pieds, renettoyée des
résidus (sable, pierre, fossiles) et enfin travaillée à la
main jusqu'à la réalisation des pains à modeler sur le tour.
La production était extrêmement variée dans la forme, la
dimension et la fonction, mais les artisans se
spécialisaient dans la réalisation de grands conteneurs,
pour huile et vin, de tuiles, vases, canalisations,
lanternes, de céramique adaptée à la cuisson des aliments,
ou enfin, d'objets décorés et plus raffinés comme des
cruches et des plats. La préparation des émaux et du
vernissage pouvait également se dérouler dans les ateliers.
Les matériaux employés dans l'élaboration ne se trouvaient
pas tous sur place, et beaucoup d'entre eux provenaient de
l'extérieur: le précieux Kaolin de la Calabre, par exemple,
et quelques minerais adaptés à la réalisation des couleurs:
l'histoire des faits culturels est toujours une histoire de
contacts, échanges, petits et grands changements,
spécialement dans les Pouilles, région de frontière, de
points d'accès et de départs. Reste le fait que les
conditions nécessaires au déroulement de cette activité
étaient offertes par le territoire et variablement
exploitées.
La cuisson se déroulait dans les fourneaux situés à
l'intérieur des ateliers. Le fourneau représentait toujours
un pari, dans la mesure où il était assez difficile de
prévoir les effets que le feu vif ou les éventuels
déplacements et chutes pouvaient causer sur les objets
empilés. Ceux-ci étaient, ensuite, testés un par un avec les
jointures des doigts du potier qui pouvait vérifier, au son
qu'ils émettaient, l'existence ou non de fissures
invisibles. A chaque fourneau était assigné le nom d'un
saint, habituellement une des références à la Madone (Marie
des Grâces, de la Miséricorde), et une ultérieure protection
était recherchée dans les prières et les conjurations.
Venons-en à présent à Grottaglie, la ville considérée
comme la capitale de la terre-cuite dans les Pouilles,
unique de la région à pouvoir se parer de la reconnaissance
officielle de "Ville de la céramique". Le titre est conféré
à 28 villes italiennes reconnues pour une tradition affirmée
de la céramique au regard de la loi 188 de 1990. Celles-ci
ont constitué l'Association Italienne des Villes de la
Céramique. Grottaglie (du Département de Tarente) est
une ville d'environ 35000 habitants située sur un col
traversé par des fissures si profondes qu'elles ont créé des
gorges dans la roche. Les grottes creusées dans les parois
de ces gorges ont accueilli, à l'époque médiévale, les
premières habitations, et l'une d'elles, dénommée San
Giorgio, où se situe aujourd'hui le Quartier des
céramiques ou des cheminées, présente une singulière
concentration de l'activité de céramique, probablement grâce
au fait qu'un cours d'eau coulait au fond. Les descriptions
antiques de la ville évoquent des cheminées fumant en
permanence, jusqu'à noircir les parois du château du dessus
et obscurcir constamment le ciel, des lueurs de fourneaux
visibles la nuit, d'une foule de gens occupés à vivre et
travailler dans les grottes: il est aisé de penser à une
sorte d'avant-poste de l'enfer.
Si Grottaglie, à l'époque récente, a réussi à
dépasser la crise qui a frappé la production de terre-cuite
dans beaucoup de localités où elle était fortement attestée,
et à affronter la concurrence des nouveaux matériaux, ce fut
probablement grâce à sa capacité à développer une production
particulièrement raffinée, parallèlement aux traditionnels
ustensiles, qui a permis aux artisans de conserver et de se
ménager une place sur les différents marchés, mais également
à l'actualisation des technologies et à l'amélioration des
conditions de travail: et, à ce propos, le rôle de l'Ecole
Royale de Céramique, instituée en 1887, et du laboratoire
annexe, a certainement été important. De nombreuses fois il
est arrivé que le conflit entre l'innovation et les
techniques traditionnelles fasse disparaître des activités,
dans ce cas au contraire la transition a été secondée et
guidée, et la présence à Grottaglie de l'Institut
Etatique d'Art, en continuité avec les objectifs de la
vieille Ecole Royale, atteste de l'importance de son rôle
joué depuis plus d'un siècle.
Depuis au moins trente ans, en effet, la situation jusqu'à
présent décrite a radicalement changé. Dans les ateliers,
l'argile arrive, de la Toscane, nettoyée et confectionnée,
prête pour le modelage. Les phases préliminaires exposées
plus haut ont donc simplement été supprimées mais également
beaucoup de celles successives, à vrai dire. Il suffit de
penser à la cuisson qui se déroule, désormais, dans des
fourneaux électriques. Dans ces conditions, de larges
espaces s'ouvrent à présent à l'expression artistique et au
goût décoratif, mais la localité de l'objet, attribut qui a
acquis toujours plus de valeur dans les dernières années,
demeure, de temps à autre, à réaffirmer au travers de
stratagèmes et autres instruments persuasifs.
Les vieilles mines étant abandonnées, la terre est réservé
aux paysans qui produisent une variété très appréciée de
raisins de table, autre voie importante dans l'économie de
cette localité. Les ustensiles rustiques, spécialement de
grandes dimensions, sont désormais désuets et ne constituent
certes pas une voie importante de l'artisanat actuel du
potier. Le cycle de la transformation de l'argile s'est,
pour ainsi dire, raccourci, dans la mesure où quelques
anneaux de la chaîne ont sauté et avec ceux-ci tant
d'efforts, tant de risques et de peurs, tandis que la phase
de commercialisation des produits peut se déployer un peu
plus. Cependant, à ces éléments de discontinuité par rapport
au passé coexistent une série de mesures qui soulignent de
forts traits de continuité et signalent la spécificité
culturelle du lieu. Parmi ceux-ci le plus important se
trouve être la conservation du quartier des céramiques où il
a toujours été, c'est-à-dire dans la gorge qui se dénoue
sous le château, ainsi que les boutiques extraites des
grottes, partiellement nettoyées de la fumée noire qui a
sali les voûtes et les parois, tout en conservant les
couloirs dans lesquels on reconnaît les espaces destinés aux
cheminées antiques.
Traces opportunément laissées découvertes qui font entrevoir
la vieille antichambre de l'enfer dont on parlait plus haut,
tandis que les fourneaux électriques aseptisés n'émettent
même pas un filet de fumée. Ces environnements pleins
d'objets accueillent pendant un temps une exposition au
public en organisant une vente tout en présentant également
les ateliers: les artisans se montrent eux-mêmes au travail
pendant le modelage au tour ainsi que lors de la décoration.
Les objets prennent forme sous leurs mains savantes d'une
technique apprise et transmise que l'on peut observer jusque
dans la phase de séchage et pas seulement comme produits
finis. Une offre globale et articulée est ainsi présentée
aux visiteurs et touristes qui, spécialement dans la saison
estivale, affluent dans le quartier: l'histoire racontant
comment cette pratique est arrivée jusqu'ici, le théâtre
dans lequel l'histoire s'est déroulée, les protagonistes à
l'action, avec paiement par carte de crédit, services de
ventes à l'étranger, informations à travers les sites
Internet des magasins isolés en plus de celui officiel de la
Municipalité.
Dans cette œuvre de retissage du présent et du passé, le
Musée local de la céramique, institué à la fin de 1999 et
splendidement aménagé dans le château du XIVème
siècle, accomplit à présent un rôle fondamental. Depuis sa
naissance, deux objectifs essentiels, qui transparaissent
dans les paroles de la directrice, se sont posés: celui de
reconstruire l'histoire de l'art potier grottagliais et
celui d'éviter l'émiettement et le démembrement auxquels
semblait destiné ce très important patrimoine
artistico-culturel. Le dispositif d'exposition, avec le
choix de l'ordre chronologique, rend évident la finalité de
présenter un parcours non discontinu de l'art céramique
local.
Le passé sert à justifier le présent et devient lui-même
marchandise, dans la mesure où, d'une certaine manière, il
est vendu avec le produit et offert à un public très vaste,
souvent venu de loin. Tout l'ensemble du passé ne s'avère
pas utile pour autant, mais une simple portion est
nécessaire à la constitution d'une corniche dans laquelle
insérer l'activité actuelle, afin de représenter une ligne
de continuité avec des pratiques en réalité disparues et de
servir de support à la particularité locale de production de
céramique, autrement indémontrable.
e mail:
imbriani@ateneo.unile.it
imbriani@sesia.unile.it
Le
terme d'origine, "lavorazione", suggère
davantage les différentes phases d'élaboration et de
préparation que le simple terme de "travail" qui ne
le sous-tend qu'à des degrés bien en-deçà. Mais
celui-ci demeure pourtant plus proche que celui de
"élaboration" qui fait perdre le caractère artisanal
de l'activité. Celle-ci intègre, en effet, non
seulement la préparation et l'élaboration mais
également la recherche des matériaux ainsi que la
commercialisation du produit fini (N.d.T.).
Droits de
reproduction et de diffusion réservés ©
LESTAMP -
2005
Dépôt Légal Bibliothèque Nationale de France
N°20050127-4889
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________________
|
|
|
|



