|
-I- PROBLEMATISER
LA PROLETARISATION
La
prolétarisation n’est pas principalement pour nous ici ce mot d’usage absolu, - quand Marx ou surtout ses descendants pressés se font marxistes, modalité d'idéologisation - qui désigne un passage qui serait définitivement adjugé du petit producteur ou de la femme au foyer dans le salariat et qui ferait de lui un prolétaire au sein d’un plus ou moins problématique prolétariat s’il aboutit dans la partie productive du salariat industriel.
La confusion des deux ordres de critères "dépouillé de ses conditions d'existence" et "ouvrier de l'industrie", voir d'un troisième plus problématique encore, appartenant à un agrégat virtuellement subjectivable, introduit des confusions dès l'origine de l'irruption historique de l'un de ces éléments. Elles ont été redoutablement verrouillées par le succès inégalement planétaire du Manifeste du parti Communiste quoique le Marx des Grundgrisse et, postérieur, du chapitre sur l'accumulation primitive dans le Livre I du Capital, et plus latéralement abordé, celui de l'achat et la vente de la force de travail, voire, antérieur, Engels de La situation des classes laborieuses en Angleterre, soient beaucoup moins approximatifs et développent, selon nous, des théories séparées de la prolétarisation dont nous nous sommes inspirés.
Elle est en revanche pour nous une catégorie dynamique de l'accumulation du capital, mal intégrable au fixisme bureaucratique telle que devenue la besogneuse "sociologie des classes" mais aussi à l'évolutionnisme perdurant. Celui ci en fait un moment historique modulé selon les espaces. Il n'est pourtant scientifiquement pas niable que l'accumulation du capital "travaille" à tous moments, dans des sens (prolétarisation et déprolétarisation), des degrés et des champs d'appropriation, divers toutes les sociétés où elle s'inscrit et qu'elle révolutionne sans fin, avec plus ou moins de résistance. Contrairement à la sociologie allemande, une pensée autonomisable de la prolétarisation a été peu poursuivie dans l'espace intellectuel français des sciences sociales, à l'exception très forte de certains historiens, de Claude Meillassoux (Femmes greniers&capitaux, Maspero 1975), et sans sa conceptualisation marxienne, dans les oeuvres sur la mobilité de Claude Thélot (Tel père, tel fils !) ; nous tentons depuis les débuts de nos travaux sociologiques (en ce registre, 1977) de la reprendre en la sociologisant et l'historicisant pour l'extraire de l'imbécile "évolution", abstraction faite, autant que faire se peut, de toute pétrification idéologique tant d'un sens de l'histoire (fut-ce la célèbre et restant heuristique "expropriation du travailleur", et surtout "Le prolétariat", mythe de massification ( cf. les fortes intuitions de M Aglieta, A Brender, Les métamorphoses sde la société salariale, Calmann-Lévy 1984) gros de récupération totalitaire, notamment au XX° Siècle.
Les acceptions de ces substantifs comme catégories de pensée, sauf à les trouver dans une situation historique et spatiale singulière et nommée (le prolétariat parisien des journées de Juin, le prolétariat agricole
de la Basse Moulouya)
ou à construire un cadre interprétatif spécifique et singulier, sont floues d’usage non fixé peu opératoire et grosses de mythologies.
En termes, osons le mot par trop abusé, scientifiques, - entendons par là de toutes les sciences sociales problématiquement plurielles, intégrant y compris le noyau de connaissance résistant de le la pensée de Marx-, il faut impérativement distinguer,
- l'analyse de la prolétarisation pense les effets de l'accumulation du capital sur les unités de vie, possessions, privatisation, familles, ménages, consommations, reproduction..., et secondairement de travail et d'emploi ; - l'analyse de la salarisation et, beaucoup plus commune, du travail salarié, notamment ouvrier pense les structures provisoirement fixées et les rapports sociaux plus ou moins fluides ou institués, en un temps et des conjonctures donnés, de "modes de production et d'échange" ;
- l'analyse de l'ainsi nommée classe ouvrière, cible massive de feu le Lersco de Michel Verret.
Elle pense, pour nous, dans une société donnée, voire un ensemble de sociétés et, selon les conceptualisations, une ou des subjectivation(s) collective(s) voire éventuellement une ou des constitution (s) tendanciellement instituée (s)en force(s) sociale(s) dans, voire "pour", l'Etat (M. Verret, Théorie et politique, Ed. sociales 1967), toujours singularisée et toujours variable et relative, même à son apogée historique, de fractions de l'agrégat ouvrier de l'industrie dans un moment historique du rapport du développement du capitalisme (mondial et national) à des sociétés singulières.
La revendication unitaire d'Une classe ouvrière est dans ces sociétés historiques toujours à l'interférence conjoncturelle de degrés et de formes de constitution en force sociale et d'idéaux collectifs plus ou moins structurés en un mythe unifiant. Elle est surtout toujours historiquement datée et devenue presque intégralement obsolète dans les sociétés centrales de la mondialisation. (J Réault, Les ouvriers de la classe au peuple, in www.sociologie-cultures.com)
On est déjà passé dans d'autres travaux ou on revient ailleurs sur tout cela, salarisation, travail ouvrier, rapports sociaux économique, culturels ou politiques, restant dans cet article dans le registre théorique de la prolétarisation éventuellement exemplifiée dans le vaste corpus de nos travaux ouvriers.
La conceptualisation à la fois sociologique et historique que nous mettons au centre de nos propos désigne l’analyse
relative de
forme, de degrés et d’ancienneté, de la séparation d’un individu, mais plus justement d’un ménage et, modalement, d’une famille d’avec tout ou partie des moyens d’existence
normalisés, conditions d’existences matérielle ou immatérielle (intellectuelles, culturelles) sociales ou sociétales (liens, communautés) dont l’ensemble détermine ou déterminait sa reproduction, vie et descendance, dans la (voire les) classes(s) ainsi l’ouvrier-paysan, le salarié patrimonial) et/ou au niveau de vie et de statut où il se trouve à son compte ou salarié pauvre ou riche. C’est donc toujours à la fois un moment d’un processus macro social et macro économique un moment historique singulier un moment biographique pour chaque individu dans une famille et dans un milieu surdéterminé par les et/ou la situation contemporaine qui en découle et que la prolétarisation, pensée aussi comme
la face humaine vécue des mouvements de l'accumulation du capital, rend intelligible.
Ainsi les
émigrés bretons qu'entraîne le choix par les
Pereire du port de Saint-Nazaire sur l’estuaire de la
Loire comme site d'accumulation du capital plutôt que Nantes, ainsi la genèse de la CANA d’Ancenis
cette immense coopérative
qui sous-traite ses paysans pourvoyeurs désormais de l'industrie
agro-alimentaire. Ainsi la
célèbre prolétarisation en masse des tisserands flamands au début de la
révolution industrielle etc., le concept de prolétarisation sera
la première clé sociologique tant que le capital restera le
moteur économique du monde, avant les classes ces fixations
soi-disant homogènes et transitoires du mouvement par les
pensées bureaucratisantes. Pour ce qui concerne notre moment
actuel le procès principal se déroule dans la dépaysannisation sur place du deuxième
vingtième siècle français et l'apogée puis le recul de l'Etat
social, (déprolétarisation, reprolétarisation).
La prolétarisation c’est
par son aboutissement plus ou moins transitoire aussi dans une unité de vie,
peut se résumer comme l’état des
possessions qui contribuent à la vie et des liens maintenus
maintenus comme moment des dépossessions (Marx dit trop
lourdement expropriations) ou des
ambivalentes
libérations en cours ou moments de leur inversion déprolétarisante.
Non cela existe, mais ce fut même la règle en Europe et
en France, sur fond de polarisation du monde par l'ambivalente
existence de l'Union soviétique, par la trilogie de l' Etat mobilisations collectives et inégales
mobilisations privatives, de
1944 à l'orwellienne année 1984, pour ce pays l'an I de la
mondialisation.
Cela
peut se passer dans la petite production (historiquement
d'abord mais aussi contemporainement), mais aussi même dans le
salariat et donc quand elle est historiquement et
nationalement constituée, dans le cours de l'existence empirique
d'une classe ouvrière.
A un niveau plus profond (et qui n’a strictement de sens
que pour le salarié qui, à l’opposé du petite producteur
ou petit marchand, n’est pas structurellement contraint aux
mobilisations privées de l’indépendance économique), et sous
réserve de ne pas l’autonomiser des critères objectifs
précédents, la prolétarisation d’un salarié et notamment
d’un ouvrier, c‘est donc aussi ce qui en modifie
éventuellement le procès, le degré d’engagement dans des
mobilisation ou simplement dans des cultures de
mobilisation séparée (privée)
intervenant même si cela ne peut être qu’à la marge, (mais cette
marge est socialement fondamentale par ses complexes et
composites effets sociaux politiques et culturels) sur les
conditions d’existence de son unité de vie.
Modalement, on l’a vu,
l'unité en est celle du groupe domestique-famille d'alliance,
sa forme et son volume, voire, éventuellement,
selon les systèmes familiaux (Todd) son lignage), caractérisée
par ses possessions et coopérations autoproductives de biens et
de services communautaires, ses capacités valorisables,
ses ressources, et indépendamment d'une appartenance
ou non au salariat. Cette dernière, entre mobilisations de
luttes sociales, institutionnalisations de leurs acquis,
mobilisations privées spécifiques selon l'ambivalente
extériorisation salariée des femmes et selon les sous-cultures
de milieux historiques populaires, apporte, dans un moment donné de l'histoire d'un Etat-nation
dans l'économie-monde, ses modes de (dé) prolétarisation propres. Si, dans
une telle
problématique, il n’y a ni degré zéro absolu ni de degré
d’ébullition univoque, il y a au moins aux deux extrêmes des
seuils historiques significatifs de mobilisation
privative exclusive et extrême ou au contraire de
perte ou l’abandon jusqu’à l’idée d’une autonomie
ou d’une initiative de vie qui ne serait celle d’un collectif ou
d'un Etat.
Partant
triplement des temps et lieux des processus historiques
généraux (guerres colonisation etc.), de l’accumulation
primitive continue (Meillassoux ) capital, des trajets
biographiques des agents dans ces deux contextes
et dans les milieux populaires concrets où ils
s’inscrivent, on analyse dans la société française et
principalement dans les sous-sociétés de l'Ouest de
l'anthropologie historique, non des états des
catégories des classes mais un procès transversal à
ces catégories ou classes non un résultat mais une
dynamique positive ou négative. Il s’agit d’approcher dans une
l’unité de vie considérée comme aussi pertinente que celle
du travail, voire plus les effets d’un tel processus sur les
conditions objectives de classes qui la structurent
et qu’ils modifient et plus encore sur les formes et
modes de vie les idéologies, les cultures
qu’ils peuvent déterminer davantage que la stricte
"situation de classe" dans le sens webérien autant que marxien,
celui du Manifeste et du 18 Brumaire non celui d'une "sociologie
de la classe ouvrière" en soi de la doctrine au LERSCO.
Une sociologie de l'accumulation du capital et non de sa fiction
immobilisée en structure
Refusant dès le point départ l’existence d’une
détermination qui pourrait servir à partir d’un indicateur
unique (comme la classe routinisée) de résumé d’une condition, - ce vocable humanitaire d'Ancien régime, nous n’analysons les niveaux et
formes de prolétarisation qu’à travers des palettes multiples
d’indicateurs spécialement construits autour des formes de
vie. Si nous cherchons des cohérences dans
l'héritage historique existant ce ne serait donc moins par de
futiles styles de vie
ou des habitus de classes bétonnées dans la nécessité
nue, qui mènent au fixisme idéologique, que dans les genres de vie de
la géographie humaine des années Trente attaché aux
réalismes des appropriations de la vie matérielles.
C'est seulement
dans les condensations plus concrètes et complexes ce qui
est tout un, de la variété des formes de vie d’une classe ouvrière nationale
approchée par
les terreaux et les découpages sociaux qui ont
produit des cultures populaires de
reproduction,
différentes que nous avons pu élaborer, empiriquement (par
l'alliance de la statistique de la carte et de l'analyse
historique et anthropologique) une indicative typologie.
Sans mettre entre parenthèse les compromis sociaux fondamentaux
et singuliers des Etats nationaux
au sein de l'économie-monde et des la polarisation mondiale, qui
constituent la trame de fond de tableau c'est dans ces sociétés et milieux historiques
spatialisés (JR
1989,1991) ) qui forment la structure historique
différenciée vivante d'une société nationale telle que la
France. C'est là que s'applique, en modes de localisation et
délocalisation, l'histoire sociale de l’accumulation du capital
dans la chaine (non linéaire) prolétarisation
industrialisation salarisation, développement.
La
localisation du capital, endogène ou exogène ne s'opère que dans moments et sur les
attributs valorisables dans l'interférence des conjonctures de son
propre processus et des pulsations propres du milieu historique
où s'opère l'implantation. Ici le capital est attiré par des qualifications
transférables, là des
métropoles de concentration humaines attirent industries de main d'oeuvre mais aussi d'expertise, là des jeunes filles non
séparées de la ferme (choletais), ici des flux de dépaysannisation (La Basse Normandie), ou de sur scolarisation
(Languedoc), là tout simplement ce qui se présenterait comme des
cultures de la soumission aux notables, (L’ouest
intérieur d’A Siegfried) ? Ainsi c’est le capital industriel
lui même qui se fait socio-historien différencié des milieux concrets
dans ses localisations, comme d’une autre façon
et plus fonctionnellement les assureurs.
Mais ce
sociologue collectif, fonctionnel et intéressé n’a
pas vraiment son correspondant scientifique et critique
dans les lieux de recherche fondamentale. La
sociologie instituée se méfie des espaces, et à des rares
exceptions près (les belges, / /) ignorent les milieux donnés, tandis que la vulgate des classes
resserre le cercle tautologique enfermant qui plus est le leurre
stérile de l'homogène alors que l'accumulation du capital
recherche avec les périphéries externes et internes (milieux
ruraux), le développement inégal, le maintien des communautés
domestiques non mercantilisées exploitables (Meillassoux), ne
survit que du composite et ne se nourrit que de qui lui est
génétiquement étranger. Sociologue bâtard et historien
résiduel, c’est notre objet de prédilection.
Prolétarisation
et Libération
(Principalement, Marx l'achat et la vente de la force de travail, Le Capital I, Meillassoux 1975 à compléter par J Réault Les trois séparations du travailleur libre-publication réservée à l'usage pédagogique jusqu'enj 2008. A paraître..)
Si la
disposition de conditions d’existence ou de fractions de
conditions d’existence est médiée par une appartenance ou un
lien contraignant, la libération à l’égard de ce lien constitue
l’autre face de la prolétarisation et si les deux processus
peuvent avoir leur temporalité, leur logique et leur histoire
propre, toute avancée ainsi nommée libératrice se paie d’un
renoncement aux conditions d’existence garanties par le lien
détruit que ce soit celui de l’esclavage ou du servage d’une
communauté domestique ou simplement d’un lien conjugal affecté
de l’obligation d’entretien. l va de soi que le concept de
Libération est beaucoup plus ambivalent, et eu égard à ses mille
usages idéologiques), beaucoup plus ambiguë ;il reste que l’on
peut aussi parler avec une rigueur mais seulement dans
l’emploi et la consommation capitaliste de la force de travail
de
libération inachevée pour la femme liée,
l’enfant, ou plus généralement le travail semi libre (assujetti
brésilien, prisonnier etc..)
La migration (Meillassoux op.
cit.) loin d’être un simple de transfert matériel
constitue un procès d’arrachement plus ou moins radical à
l’égard d’un ensemble de liens sociaux et sociétaux liés à
l’autochtonie, elle constitue souvent une modalité et en tout
cas un moment des libérations et lorsque la salarisation se fait
sur place sans que soit totalement décomposé l’ordre ancien de
domination, dépendance de fait, lala libération du travailleur
libre risque d’être elle même moins achevée. 11
Dans
l’actuelle conjoncture de mercantilisation
conjuguée des conditions de vie des cultures
hégémoniques et des légitimations du compromis social via un
droit envahissant, par définition marchand, les idéologies de la
libération des sexes et des âges qui constituent l’ultime façade
de changement social de la part du pouvoir, la valorisation
médiatique des modèles de formes de vie non liés, la relative
bonne volonté des distributeurs du salaire indirect à prendre en
compte les formes de vie non liées ou déliées, la prétention
d’armées croissantes de travailleurs sociaux à
moderniser
(pousser aux séparations) les formes de vie des femmes et des
jeunes des classes populaires affectées par le
chômage et les marginalisations, tout pousse sur le socle
déterminant de crises des liens induites par les procès
économiques la précarisation la concurrence et le chômage
marginalisations de société duales.
Ces libérations
c’est à dire ces dissolutions de liens et de communautés (dans
le fil des analyses du Marx des
Formen et du travailleur libre)
moins ambivalentes sont désormais, - en France aux Etats
Unis les études abondent sur ce thème-, le vecteur principal des
nouvelles prolétarisations voire marginalisations. Leurs
principales victimes, les multitudes de la nouvelle pauvreté
sont à l’instar de la situation des débuts de la révolution
industrielle, les femmes et les enfants, les fétiches hypocrites
avec l’individu de la société du spectacle et de ses
pouvoirs modernisateurs. Les prospectives catastrophistes du
Claude Meillassoux de Femmes Greniers et capitaux,
pourtant écrites à l’aube de la crise s’avèrent sur ce point
déjà dépassées.
Degré de Prolétarisation ou mercantilisation de l’existence
Toute prolétarisation, si on exclut la survie parasitaire, est de facto condamnation au marche, marché de la force de travail pour la salarisation, marché des marchandises pour la reproduction marchés noirs de la débrouille et marchés gris croisant la pègre ..Cette mercantilisation est elle aussi
affaire de degré et de ce point de vue le remplacement du
travail domestique de production finale de valeurs d’usage pour
la consommation par l’achat de marchandises prêtes à consommer
constitue aussi une prolétarisation.
De la
même façon et paradoxalement la salarisation de fractions jusque
là épargnées de la réserve domestique (femmes ou enfants) est
aussi une prolétarisation d’abord par ce qu’il il ne faut pas se
hâter de mettre trop vite sur le plateau univoque de
l’enrichissement empirique l’apport d’un nouveau salaire
indépendamment du bilan algébrique de ce manque à produire pour
soi et de ce supplément à acheter (mercantilisation de la vie)
des marchandises contenant de la plus-value pour autrui ensuite
par ce que même s’il y a enrichissement ponctuel il n’y en a pas
moins prolétarisation et l’on peut ainsi saisir concrètement une
des modalités de la différence entre paupérisation et
prolétarisation.
De la
même façon et à un niveau beaucoup plus transparent
le passage au salariat d’une très large fraction de la petite
paysannerie dans les années 50, pas seulement mais aussi par ce
qu’il se situait dans le moment des Trente Glorieuses et de
l’accès à
l’âge d’argent (cette si bonne formule de M. Verret dans un
livre qui manque si radicalement son "objet" le Travail
ouvrier vivant qu'avait saisi avant lui J Deniot) de la classe ouvrière de France dans
son ensemble, correspond bien à une prolétarisation le
plus souvent irréversible (séparation d’avec ces conditions
d’existences jusque là liées) dans le moment même d’un
enrichissement pour ce qui concerne le revenu monétaire
aussi bien que l’accès aux valeurs d’usage de la production et
consommation de masse. La prolétarisation
au sens absolu mais conceptuellement superficiel de la salarisation a été idéologiquement
masquée par le cumul des jubilations, celle classique de
l’accès au salaire régulier, celle inespérée de l’entrée de
facto dans la consommation de masse, des libérations de
vie, et dans la patrimonialisation autour de la maison voire du
jardin Du Bourdieu du Partage des bénéfices au Touraine d’Ouvriers d’origine agricole (Seuil)
par N. Eizner et bien d’autres, on a décrit avec tellement de
complaisance évolutionniste alors cette bonne volonté des
anciens paysans nouveaux ouvriers à être salariés et même
urbanisés, mais l'obsession d'une homogénéité à rétablir
d'urgence verrouille leur analyse dans les destins confus de la
nouvelle aliénation ou d'une domination adjugée sans portes
ni fenêtres. Alors que triomphaient certes
contradictoirement la privatisation malgré tout heureuse et
l'individuation malgré tout libératrice.
Prolétariat
et salariat
On
revient plus longuement sur ce thème en annexe.
Le tour
d’esprit assimilant l’ouvrier au prolétaire
indépendamment des glissades et des confusions qu’il a
engendrées a évidemment une vérité théorique fondamentale
(quoique le singulier soit toujours en sciences sociales d’un
usage redoutable); il repose sur la recherche d’un seuil décisif
dans le changement de qualité (d’un être social ici). Il n’est
pas question de minorer l’importance de ce seuil qui signifie,
la séparation dans le travail (mais cela ne dit rien de l’unité
de vie) du travailleur salarié du moyen et du produit du travail
et surtout la perte de sa direction. Mais ce n’est pas notre
propos déjà pourvu de milliers de livres. Mais dans un monde ou
85% des actifs le passent il importe plus que jamais de ce
donner les moyens supplémentaires pour différencier les 85%
et cela ne signifie en rien ignorer et minorer la déterminations
principale qui l'a séparé des 15 autres.
Mais à
partir du moment où l’on sépare, logiquement,(sans se laisser
attendrir par les interférences manifestes sur lesquelles il
faut revenir dans un deuxième temps ) de façon radicale
prolétarisation et salarisation on peut se donner des
indicateurs également matériels comptables et expérimentalement
efficients pour mesurer au sein des mondes ouvriers. Mais
il faut pour cela mettre entre parenthèse d’abord l’unité
et le lieu du travail salarié pour repérer dans les
unités de vie (résidence ménage famille à) les degrés et
formes de la séparation.
Nous ne
sommes pas seuls, indépendamment des élaborations précieuses
mais abstraites d’André Gorz, à approcher des terrains ouvriers
populaires avec ce type de questionnement mais les travaux les
plus significatifs concernent davantage les sociétés
périphériques (via la Revue Tiers Monde ou
l’œuvre remarquable de Gérard Heuzé dont la recherche a déjà
d’ailleurs croisé celle du LERSCO.
II PROLETARISATION du PETIT PRODUCTEUR
PROLETARISATION
INACHEVEE DANS LE SALARIAT
L’intelligibilité des mondes ouvriers n’est pas strictement sociologique mais fondamentalement historique
Prolétarisation des Petits producteurs
La
prolétarisation ou un mot pour
sociologiser l’expression extrême
philosophiquement adéquate mais empiriquement trop
abrupte d’expropriation des travailleurs (petits
producteurs) selon la célèbre formule de Marx… Elle
intéresse strictement notre propos dans la mesure où l’espace
français a connu une immense et ultime(?) industrialisation
entre 1945 et 1980 parfois plus tard dans le mouvement
même d’une monstrueuse dépaysannisation dépassant par ses
rythmes et intensités ce que les enclosures anglaises ou
l’industrialisation stalinienne avaient osé. La
forme et les degrés déprolétarisation français s’inscrit d’abord
dans cette proximité spatiale et temporelle (sans
migration. Plus que jamais il convient pour sociologiser la
prolétarisation des ouvriers en France de penser que non
seulement ce
passé n’est pas mort mais il n’est pas passé (Faulkner)
Dans
un usage strict la prolétarisation est par excellence un
attribut de petits producteurs marchands affrontés à la
production capitaliste perdant dans les formes apparemment
conservées d’autonomie soit certaines déterminations
de cette activité indépendante soit une part croissante du
revenu soit le temps de reconstitution et de repos qu’il
faut mobiliser pour maintenir le revenu voire l’existence.
L’analyse de classe de cette prolétarisation constitue en
théorie ou devrait constituer, à l’échelle de la planète, si
l’échelle des questions et leur importance sur l’existence du
plus grand nombre d’homme était le critère du choix d’objet des
sciences sociales la grande question sociologique de
l’heure. Ce n’est évidemment pars l’avis des chantres de la
modernisation
désormais de tous bords.
Contrairement aux illusions de leurs hymnes
entêtants
c’est encore la majorité de l’humanité qui assure son existence
hors du salariat. Et même en France 20 ans après. d’un
d’une part les paysans n’en finissent pas de finir
d’autre part; c’est sur leurs viviers encore féconds que
d’ultimes accumulations s’effectuent.(Le chiffre absolu des
emplois industriels a cru dans certaines parties de l’Ouest
jusqu’au milieu des années 80). Ces modalités des
prolétarisations de petits producteurs essentiellement familiaux
sont pour notre objet d’une importance stratégique .Elles
apprennent par définition à penser la prolétarisation non
comme une essence mais comme un procès, comme une affaire de
degré de rythmes de différences, aux effets pertinents sur
d’autres pratiques et cela au sein d’une même - apparente
situation socio-économique dans la même C.S.P. au
regard administrant de l'INSEE et du sociologue disciplinaire. Nous ne proposons rien d’autre qu’importer la même façon de
percevoir et d’analyser au sein même des mondes ouvriers qui eux
mêmes continuent souvent de reproduire leur vie dans le sein de
milieux où ils forment un même peuple horizontal
consubstantiel aux paysanneries survivantes.
Par ailleurs ces petits producteurs sont, eux leur culture et leur poids dans les tissus populaires horizontaux, la clé de la compréhension et des attributs de liens et de possessions des ouvriers salarisés sur place venant du vivier de
leurs familles et/ou des faillites de leurs exploitations. Les
cultures de reproduction les valeurs et modèles concernant
les formes de vie et les rapports entre les sexes, les
formulations du rapport des femmes à l’emploi et bien d’autres
attributs des ouvriers prolétaires inachevés prennent leur
traits singulier dans les attributs spécialement des
paysanneries dont ils viennent et au milieu des quelles ils
continuent souvent de vivre. Ainsi nous avons mis en
évidence le poids fondamental des formes et échelles de la
propriété ouvrière sur les cultures ouvrières révélées par des
indicateurs spatiaux (JR 1989 et l’autre communication à
ce colloque).
La petite propriété héritée a ainsi transmis aux
ouvriers qui n’ont pas quitté ses milieux méridionaux une
bonne volonté scolaire différentielle et un attachement au
mouvement ouvrier historique d’avant la CFTC - CFDT) une
méfiance pour la salarisation précoce des femmes etc. Ainsi la
moyenne propriété (Aveyron Vendée etc.. ou la propriété paysanne
acquise au 20° siècle avec des solidarités de milieu de
type ecclésial (Bretagne) a transmis aux ouvriers nés sur ces
terres en multitude avec les Trente Glorieuses a réserve à
l’égard de l’école ses ambitions de formation modestes, son
fétichisme de la patrimonialisation. Et c’est tout
l’espace français qui peut devenir le champ de telles
interrogations dans laquelle les transferts matériels et
culturels de la petite production à la classe ouvrière
constituent la clé principale d’intelligibilité des
comportements de celle ci dans ces milieux localisés autant et
plus que les effets de classe de son travail usinier.
La prolétarisation inachevée dans les mondes ouvriers
Nous parlons de prolétarisation inachevée lorsque des salariés et notamment des ouvriers maintiennent pour assurer leur existence tout ou partie des possessions liens ou savoirs valorisables suivants évidemment non limitatifs.
1°) soit de véritables double activités (ouvrier-paysan)
2°) soit des double appartenances pourvoyeuses de services gratuits (le jeune ouvrier encore entretenu chez ses parents petits producteurs) le fonctionnement maintenu et extrêmement fréquent du jeune couple avec les familles.
3°) soit possessions utilisables dans une auto production d’usage propre ou de marché noir. Seule
la mercantilisation absolue pourrait éradiquer cette dernière
pour autant que l'unité de vie qui est également de résidence de
pot et de feu reste l'unité séparée de la vie encore ordinaire.
4°) soit des possessions constituées de biens durables (logement) épargnant des consommations marchandes et de liens valorisables qu’ils ont transféré dans le passage de leur propre salarisation voire de leurs parents.
5°) Soit tout simplement des liens communautaires (comme conjoint au foyer, ou jeune descendant adulte) qui leur donnent disposition des biens st services sus évoqués.
6°) Soit de ce nous appelons un savoir faire (évidemment
ambivalent) d’autochtonie
par leur immobilisation enracinée sur des milieux d’origine :
-
ressources d’expériences immatérielles car ces milieux sont
porteurs de frayages sociétaux de réseaux d’expériences de
recettes pour faire face à des situations de la vie
professionnelle ou privée, clientèles pour l’accès à l’emploi
entraides, réseaux de prêts. Tous savoirs et expérience qui ne
sont valorisables que sur place.
- et
même biens d’usages collectifs matériels (pour la chasse
pèche cueillettes, usages communs des briérons etc...)
7°) La contre mobilité positive analysée par Cl.
Thélot,
des fils d’ouvriers petits fils d’agriculteurs ou d’artisans en
constitue un autre type sans patrimoine matériel visible mais
sur la base d’un dit capital social (dans
l’approximation ici particulièrement glissante de P. Bourdieu),
et même pas nécessairement scolaire, effectif ? Modalement des
schèmes d'organisation de direction de coopération transmis des
pratiques travailleuses de la petite production tout sauf un
capital!
A partir d’un certain nombre de ces traits cumulés et tout spécialement dans cette salarisation sur place
qui a été le mode majoritaire des Trente Glorieuses
notamment dans l’Ouest français (sous réserve d’appeler sur
place la vie à portée de voiture d’une demi journée du
lieu d’origine) à partir d’un certain seuil liens et possessions
différentiellement valorisables comparativement à l’ouvrier
strictement dépendant du marché, constituent des schèmes
de comportement entrant en combinaison dans les formes et
symbolisations de vie concurrents de la dite matrice
d’usine ou de marché d’autant plus prégnants qu’ils
reproduisent et renforcent ces capacités (Y Clot) d’origine
qui constituent l’angle aveugle de toutes les sociologies
structuralistes de la pure classe ou de culture
idéaltypique de classe, à plus forte raison faut-il le
dire de
l’individualisme méthodologique quand il se réduit
à une sociologie de l’homme sans qualité du droit marchand. On
se propose dans la fin de cette communications d’évoquer
quelques effets de ces capacités tirés de divers travaux et pas
seulement les nôtres.
On ne
peut plus penser ces attributs avec le dédain des
économistes pour ce qu’ils ont curieusement nommé par une
tardive redécouverte, et d'entrée mal connotée, de la valeur
d’usage économie souterraine comme simple appoint
du salaire. D’autres ont découvert tardivement qu’en Italie cet
appoint peut être principal dans la forme familialiste de
la prolétarisation inachevée adossée à une fonction publique
malingre mais universelle. On ne peut non plus se satisfaire de
la fixation sexiste réductrice des recherches
post-féministes découvrant à juste titre le caractère
productif du travail domestique des femmes et oubliant le
bricolage productif et l’autoproduction des hommes Il est vrai
que l’expérience parisienne ne favorise pas plus la rencontre de
la prolétarisation inachevée que celle du peuple qu'il soit
chasseur paysan ou ouvrier. 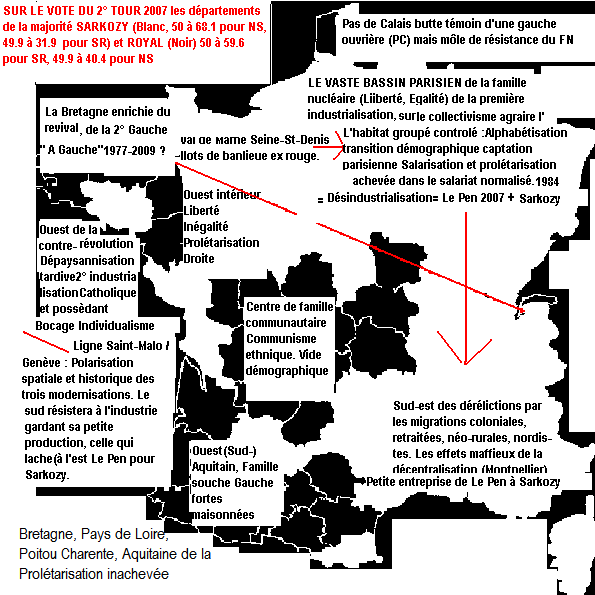
Carte synthétique extraite de J Réault, Nicolas et Ségolène ou le mystère de la Dame de Vix, une sociologie politique des élections présidentielles en France référées aux formes de prolétarisation in J Deniot, J Réault, Espace, Temps et territoires. Cahier du Lestamp N° 2 Nantes 2010. Carte corrigée de l'erreur indiquant prolétarisation inachevée dans le Nord-est politique, alors qu'on y a l'épure française de la forme prolétarisation achevée, comme indiqué ici, et complétée pour cette édition web sur la géographie schématique de la prolétarisation inachevée (coin bas gauche)
III - Prolétarisation achevée dans le salariat et inhibition de la mobilisation privative
La
Prolétarisation
- essentiellement ouvrière-, achevée, est l’autre
face de notre approche propre conceptuellement polarisée.
L’expression existe et a été produite par André Gorz dans l’Adieu
au prolétariat (Seuil).
La
prolétarisation
achevée dans le salariat lie toujours aussi et quoiqu’ils
soient dans ce cas souvent radicalement séparées, le travail et
l’unité de vie dans leur globalité et le rapport du
travailleur au travail comme à cette unité où, dans le
lexique structuraliste althussérien le « rôle dominant » dans la
forme est tenu par l’habiter et le groupe domestique, le household
de Peter Laslett. C’est une limite idéale en même
temps qu’une possibilité empirique existante. Elle serait
véritablement scellée, si l’on suit le regard quelque peu
post-catholique moralisateur d’A Gorz que lorsque la perte de
conditions d’existence propres à l’exclusion du salaire
est redoublée par le renoncement à toute tentative autonome de
mobilisation privée de la force de travail non consommée par le
capital pour quelque mobilisation (entreprise ?) séparée de
l’Etat,
d’autres collectifs prolétariens ou d’appareils de masse. Ce
renoncement - qui est pour nous un questionnement non une vérité
générale adjugée, stratégique-, à l’autonomie privée pour agir
sur ses conditions d’existence ressortissant plus d’une
dimension psycho sociale et culturelle que d’une détermination
strictement matérielle doit donc être rapportée aux systèmes
(nous avons écrit, écosystèmes (JR 1989) de reproduction des
êtres humains, historiquement économiquement et culturellement
définis on pourrait dire plus simplement aux milieux culturels
historiques (incluant notamment les systèmes familiaux
d’Emmanuel Todd)
dans un sens fort incluant le cultures matérielles si l’usage de
ce concept n’était par trop inconstant. Nous préférerons dire,
comme pour l’ensemble de cette analyse les positions spatio-historiques
dans l’histoire du développement, incluant l’accumulation du
capital, l’Etat et les mobilisations populaires. Nous préférons
dire dans notre deuxième communication à ce colloque, les tissus
de cultures populaires horizontales ou pour faire court, et dans
une acception de sous-ensembles localisés exclusivement,
l’ellipse des peuples.
Cette prolétarisation achevée n’est d’ailleurs pas
seulement définissable par des attributs négatifs. La fécondité
démographique, la culture prolétarienne de la bonne vie,
l’adaptation à la mercantilisation générale de la vie –
communauté familiale et, tant qu’elle dure camaraderie d’usine,
exclues
a été mainte fois décrite dans les analyses des ouvriers
de Grande industrie des 19° et 20° Siècles de
Engels de la
situation des classes laborieuses en Angleterre
à la si mal rebaptisée Culture du pauvre. Nous en
avons décrits concrètement une modalité historique proche de
nous dans les mondes ouvriers de première industrialisation, le
premier peuple nazairien et surtout les tissus ouvriers
collectivistes de la fraction du territoire français touchée la
première par l’histoire du développement puis la première
révolution industrielle. Cette forme de vie ouvrière, pour
nous historique, (J Réault 1989) confirme tous ces traits qui
sont déjà ceux d’Engels sur l’ouvrier anglais, mais nous sommes
les seuls à les rapporter à la continuation des cultures
populaire et paysannes de la civilisation agraires (Mac
Bloch) de l’habitat groupé et du collectivise productif et
villageois de la grande plaine du nord de l’Europe et pas
seulement du Nord-est de la France et de la ligne d’histoire du
développement que symbolisa dans l’historiographie Saint-Malo
Genève. On y renvoie le lecteur.
Un essai de systématisation des caractères propres
de cette dimension prolétarienne au sein des cultures ouvriers a
fait l’objet d’un article récent de Michel Verret - Sociologie
du Travail 1989), nous n’en partageons pas les glissements pour
le moins condescendants. Dans la mesure où elle se situe dans le
salariat la prolétarisation achevée version A Gorz reste un
concept clair .IL est en effet impossible de penser une
sorte de degré zéro de la prolétarisation sauf à sociologiser la
misère absolue (ou la culture de pauvreté de
l’ethnographie américaine) ce qui n’est pas notre objet et
éloigne d'une problématique de la prolétarisation. L’intérêt du
concept gorzien est qu’on peut l’éprouver empiriquement par ses
effets culturels et politiques généraux.
La
question des effets pervers du salaire indirect géré par des
appareils centraux : l’Ouvrier entretenu
Privation de tout objet ou moyen de mobilisation séparée,
et de la problématique même (voire du désir) d’une autonomie
disqualifiée et considérée comme vaine et illusoire, la
prolétarisation achevée dans le salariat telle que la modélisait
André Gorz l’Etat Providence et le mouvement ouvrier
les œuvres sociales social-démocrate voire les horizons
du communisme mondial organiquement liés pour la résolution
collective des questions liées au travail comme celles de la
reproduction séparée (le ménage de l’entreprise ).
Un mot
d’abord sur cette séparation du ménage et de l’entreprise
Abstraction faite des politiques d’emploi familialistes qui sont loin d’avoir disparu de la SNCF, des
patronats provinciaux traditionnels et surtout des
systèmes paternalistes maintes fois décrits, la séparation du
ménage et de l’entreprise continua d’être plus
sournoisement mise en cause jusqu’à l’apogée
de la collectivisation de la vie dans les années 60. Le
mouvement ouvrier classique qui avait pris le relais et cette
tendance devait d’ailleurs autant aux héritages syndicaux de la
Lotharingie industrielle et aux social-démocraties qu’au
communisme comme tel à se réduire par le lien, institué dans des
démocraties populaires mais fréquent à l’Ouest via les comités
d’entreprises ou la sociabilité post-paternaliste des Vosges du
Creusot du Pays minier etc., entre le collectif
d’entreprise et une partie de la consommation, de gestion du
temps libre et des loisirs, des vacances etc. En France c’est la
CGT qui s’identifia le plus au maintien ou à l’acquisition de
services autour du lieu de travail et de ses
institutionnalisations patronales ou
paritaires. Jusqu’au logement par l’employeur qui n’a pas
partout disparu au Nord et à l’Est et qui pour la CGT peut aussi
être perçu comme avantages acquis.
Mais
n’est-ce pas tout le système de gestion du salaire indirect qui,
contradictoirement au formidable progrès et à l’indicible
conquête qu’il constitua à l’échelle de l’histoire du monde pour
des multitudes de travailleurs des Centres confrontés à la
maladie la vieillesse etc., qui induit aussi de façon
latente et dans certains
écosystèmes de reproduction,
une culture étatiste de famille ouvrière culturellement
collectiviste protégée, entretenue et passive face à tout
« entreprise » privée ?
Cette
matrice culturelle a peu d’effet sur le prolétaire inachevé ou
l’ouvrier autonome pour parler vite mais redouble et
renforce la passivité et l’absence de mobilisations chez le
prolétaire achevé dans le salariat.
Prolétarisation achevée dans le salariat massification et socialisme
Quoi
qu’il en soit c’est une prolétarisation si l’on ose dire
déprolétarisée par la société salariale et conjurée par
l’emploi stable qu’il s’agit puisqu’un nouveau lien historique
était rétabli entre le travailleur stable et des conditions
collectives d’entretien de sa vie. N’est-ce pas d’ailleurs la
définition même du socialisme, ce que crurent d’ailleurs les
partis sociaux-démocrates .Deux différences fondamentales
cependant .La première c’est que même à l’apogée des
Trente Glorieuses et du fordisme, seul une détermination
extérieure à ce lien garanti, le plein emploi permettant de
préjuger la reproduction générationnelle de lien,
pour ses enfants et c’est d’ailleurs par le biais des
générations que les vingt années suivantes celles de l’ainsi
nommées crise virent mettre en pièce ce lien lui même.
La
seconde c’est que si on définit le socialisme comme l’état
social voire peut-être l'Etat social, des travailleurs
associés.Tout revient alors à la question de la norme de
l’association et de sinon de sa réversibilité (gros
problème), les questions liées de l’unité et de l’échelle
de gestion (centrale ou locale pour faire vite) et de la
démocratie dans cette gestion. Le paradoxe de l’ouvrier
travailleur associé du fordisme était que la culture de
travailleur libre tendant pour le prolétaire achevé dans le
collectivisme de salaire indirect à disparaître au profit d’une
culture passive de délégation. A la limite l’acte d’association était comme dans les théories réalistes du lien social rapporté in illo tempore ou du
moins à une origine qui pour être historiquement datée était
définitivement scellée.
Un des
attributs fondamentaux de la situation prolétarienne définie par
la nudité des moyens d’existence cumulée à l’affaiblissement ou
la disparition des liens de la reproduction et à la
dédifférenciation qui résulte de l’exclusion de la division du
travail ou de la situation de multitude indifférenciées dans des
tâches subalternes (l’OS du fordisme), est la tendance possible
à la massification. La massification repose sur cette
situation de multitude sans normalisation de son rapport aux
ressources rares confiné dans l’isolement individuel par
l’absence de liens et surtout fondamentalement par les
processus multiformes se glissant dans tous les interstices de
la vie sociale de la mercantilisation.
Mais la massification
peut être par surcroît(et le vingtième siècle déborde de ce
surcroît) se reproduire et s’intensifier par une
gestion de masse réaliste ou idéologiquement sublimée (et
le plus souvent sous ces deux auspices par des organismes très
variés communistes catholiques ou autres ; ce vocabulaire,
pourtant sourdement mortifère dans le mot même, cette
technologie sociale cette problématique de la gestion de masse
constituent à la fois la vulgate du siècle, sa grande invention
régressive, et s’est présenté au travers de culture d’appareils
qui comme tout appareil est à la fois séparable et inséparable
d’une base sociale.
Ainsi
contrairement au schéma trop évolutionniste malgré son audace
conceptuelle, de Michel Aglietta et Anton Brender ,
la massification peut perdurer au sein de classes ouvrières
constituées par son mouvement autant que par l’Etat de société
salariale pour autant que la prolétarisation y atteigne un
certain seuil et que le mode de cette constitution en classe
soit plus autoritaire bureaucratisé délégué. On a désormais pour
l’appareil communiste et CGT des analyses montrant les ouvriers
ou salariés garantis, les plus entretenus par l’Etat providence
donnant le ton à l’égard des fractions les plus prolétarisées ce
qui est plus attendu et même des fractions gardant des
bases matérielles et des cultures de l’autonomie par le métier
.On connaît moins, à l’ouest les bases et les formes d’un
certain populisme de masse(visible dans la Basse Loire des
années 50) cumulant des cultures indigènes
post-paysannes à des techniques sociétales d’Eglise autoritaire.
N’est-il pas paradoxal que, à notre connaissance le seul titre
de revue qui maintienne le mot masse pour se référer aux mondes
ouvriers, Masses ouvrières soit un organe de la J.O.C. Certes la
base
naturelle seule disponible d’un tel populisme d’église
moderniste, les nouveaux salariés des Trente Glorieuses au
sein d’une prolétarisation inachevée n’étaient massifiables
que jusqu’à un certain point du fait de ce maintien des
liens et possessions privées ; mais d’autres dimensions de leur
prolétarisation inachevée spécialement sociétale et
culturelles, condensées dans leur salarisation sur place et leur
enracinement au sein de ces terres qu’André Siegfried
osa qualifier de pays de la soumission, peuvent
aussi induire des passivités de masse à l’égard
d’interpellation de masse qui leur apparaisse liée aux autorités
légitimes mais ceci est une autre histoire dont nous
dirons simplement qu’elle n’est pas nécessairement passée à la
trappe de l’histoire par les miracles du bon pape Jean.
Inutile
de dire que cette prolétarisation massification ne concerna à un
fort degré qu’une fraction de cette classe ouvrière mais
celle qui était interpellée et qui agissent d’ailleurs comme la
plus consciente parce que la plus ancienne et la plus
expérimentée mais qui s’avéra la plus handicapée lorsque
les processus sociaux de la dérégulation et la crise
contraignirent à affronter les mobilisations privées pour
assurer sa reproduction.
Applications de la problématique
Prolétarisation inachevée forme de vie et syndicalisme
L’essentiel d’une telle approche s’impose d’entrée dans
la classe si l’on ose dire, par la porte de la résidence
et via ce nœud d’opacité qu’est la famille. Passer par les
formes de vie pour penser les vies ouvrières réels dans
leur extension et leur variation réelle n’est pas neuf. D’autres
l’ont fait depuis longtemps. Mais les philanthropes et autres
bons docteurs Villermé coururent d’abord aux urgences c’est à
dire aux populations les plus radicalement prolétarisées par le
développement de la grande industrie de l’est de la ligne
Saint-Malo-Genève. Plus tard vint le temps des sociologues
dits réactionnaires mais si féconds à l’instar de
Frédéric Le Play, bien placés par leurs attaches
provinciales et rurales pour percevoir, spécialement dans
l’espace français une classe encore majoritairement liée
aux mondes de la ruralité voire de la petite propriété
souvent appendice des paysanneries qui les accueillait dans ses
communautés familiales en temps de chômage (encore dans les
années 30 analysées statistiquement par Robert Salais) ce mode
d’approche les mit d’entrée en contradiction avec ce qui
s’était déjà constitué en savoir utile et déjà pensé dans une
logique d’orthodoxie pour le mouvement ouvrier constitué et plus
encore pour ses idéologues. Pourtant, jusqu’en 1936 où l’ex CGTU
réussit leur introduction dans le mouvement syndical les
ouvriers les plus prolétarisés et les moins qualifiés et à peine
moins les femmes, sont à peu près absents des organisations
ouvrières et en tout cas n’y donnent pas le ton.
Cette direction et ce ton sont paradoxalement l’apanage
d’ouvriers qui par leur métier leur proximité de l’artisanat
sont loin d’être les plus prolétarisés dans le
travail comme sur le marché mais qui souvent célibataires et
héritiers d’une culture de marché compagnonnique de la mobilité
sont souvent célibataires et indifférents à la stabilisation
résidentielles et familiale dans le temps de leur vie salariale
active et donc de leur militantisme. Cela contribua, y compris
dans son héritage à Force ouvrière Après la 2° Guerre, et dans
une convergence avec l’idéologie communiste du privilège
donné aux socialisations d’entreprises sur la vie privée à
abandonner à la CFTC puis longtemps à la 2° Gauche des
revendications assumant sans complexes les processus
sociaux inducteurs et les revendications conséquentes concernant
la vie privée. Ce décalage et ce retard pris le mouvement
ouvrier classique l’approfondit par une rechute au moment de la
salarisation massive des femmes à la fin des Trente Glorieuses.
La crise du syndicalisme français nous apparaît ainsi
notamment éclairée par ce décalage entre des idéologies du
prolétariat du prolétaire achevé notamment à la CGT (cf.
A. Gorz) ou du marchand négociateur individuel indifférent à la
famille (FO) et le poids immense de la prolétarisation inachevée
dans les mondes ouvriers issus des Trente Glorieuses et
de la Crise
qui éclate en 1974.
Ce sont chez les deux héritiers de la grande CGT et des
appareils où règne l’ouvrier garanti effectivement
proche du prolétaire achevé que livrent à la fin de la
Guerre Froide ces luttes théoriques qu’on
pourrait qualifier de picrocholines si elles n’apparaissaient
a posteriori tragiques par l’intelligence et la générosité
gâchées et l’indifférence à une histoire qui n’a pas repassé
les plats, sur la paupérisation absolue ? On
lance des procès d’ infamie aux sociologues maladroits qui
dissertent de l’embourgeoisement de la classe ouvrière
Cette formule faisait mouche bien qu’elle assimilât
avec une rare bêtise les sécurités relatives de la société
salariale la familialisation et les prémices de mobilisations
privées aux conditions d’existence d’une bourgeoisie faute d’une
pensée théorique claire et assumée de la prolétarisation
inachevée ou des mobilisations privées.
C’est alors que le concept de prolétarisation inégale aurait dû s’imposer et l’on en fut pas moins ; il y a dans l’œuvre du premier Touraine sur les milieux et les effets d’origine
des prémices d’une telle approche mais les schémas
évolutionnistes et la spectacularisation du thème de la
nouvelle classe ouvrière et son appropriation polémique par
la nouvelle (deuxième ?)Gauche comme instrument de lutte
contre l’archaïsme de la vieille classe et de la
vieille Gauche mobilisèrent la plupart des énergies
dans des luttes contre des moulins à vent.
Nos propres travaux sur l’Ouest (1983) et l’aire
nazairienne (1991)
nous ont permis de saisir dans le temps semi long du vingtième
siècle, l’événementialité du mouvement ouvrier et les structures
du vote social les tropismes que nous n’avons pas l’espace
d’expliciter plus longuement de l’appartenance syndicale et du
degré de prolétarisation dont une des composantes
supplémentaires est l’ancienneté de la salarisation (qui
rééquilibre les habitus). Des trois peuples (pas
seulement) ouvriers dans la geste desquels nous avons
esquissé un type idéal de l’histoire ouvrière nazairienne, le
plus prolétarien a confondu ses manifestations et appartenances
avec l’héritage d’après Guerre de la CGTU au sein d’une CGT où
ils côtoient les ouvriers de métiers indigènes ou extérieurs les
plus anciennement salarisés et les moins possessionnés.
Les
ouvriers de métier garantis, enracinés et modalement
propriétaires sont la base de F O en recul par ce que grignotée
par la promotion vers le haut et sapée, dans le temps long, par
son malthusianisme relatif. Les prolétaires inachevés de
l’industrialisation des Trente Glorieuses ont constitué avec les
techniciens et ouvriers qualifiés ayant réussi leur sortie de la
paysannerie ou correspondant au troisième temps de la contre
mobilité forment l’essentiel de la base de la CFDT (la CFTC
maintenue étant négligeable) mais c’est toute l’histoire
ouvrière nazairienne qui n’est intelligible qu’au regard des
degrés et formes de prolétarisations ; Ces ouvriers dont
la société du spectacle naissante fit les emblèmes de la
radicalité ouvrière sont dans leur globalité les plus
propriétaires de France (sur environ 380 aires d’emploi )Saint
-Nazaire, la rose, étant, toutes catégories confondues,
l’agglomération où le taux de propriété du logement
est le plus fort.
Prolétarisation inachevée classe ouvrière Eglise et
vote politique
On partira d’une des œuvres qui fit date dans la sociologie électorale. France de Gauche vote de Droite (PFNSP 1981)
de Capdevielle Dupoirier Grunberg, Schweisguth, Ysmal).La
découverte de l’effet patrimoine ouvrait une politologie
électorale qui en conservant l’acquis des classes ou du moins
des CSP au moins comme moment de l’investigation, créait
transversalement à celles ci une intelligibilité exclusivement
construite sur les variations de la possession réduite dans le
livre à des indicateurs relativement peu nombreux mais
extrêmement efficaces. Ce livre élargissait
d’ailleurs certaines découvertes faites notamment par G
Michelat et M Simon
L’analyse du cumul des attributs ouvriers induisant le
vote politique d’esprit relativiste et empirique
dans un cadre théorique clair donnait un premier coup
scientifique et probant à la classe absolutisée. Nous
dirions dans notre problématique, qu’à une certaine réserve près
de nature plus anthropologique que sociale, conservant des
ressources sociétales et anthropologique post-communautaires qui
sont aussi des héritages de la Nièvre à la Dordogne,
l’électorat du PC regroupait (et regroupe encore) le maximum de
salariés pas trop marginalisés mais dans la situation la plus
prolétarienne à côté du maximum d’ouvriers garantis
(EDF EGF SNCF etc.) prolétaires achevés gorziens idéaux pour un
regard un peu malveillant
ou stratèges rationnels d’une socialisme réalisé dans un
seul secteur d’un seul pays et surtout au sein de cette
solidarité qui vient à manquer depuis que les représentants ont
viré de bord en voulant garder le pouvoir, avec à la fois l’Etat
national et les intellectuels jusque là hégémoniques.
Nous avons ? il y a une dizaine d’années d’année,
donné une description de cet Ouest dont les sociétés
accueillirent l’industrialisation des Trente Glorieuses dans
laquelle ce principe d’analyse lié à l’aléa de l’accumulation,
constituait la trame d’intelligibilité principale. Les
classes ouvrières induites par l’industrialisation différaient
notamment selon que les paysanneries viviers étaient
propriétaires ou non. Il n’est pas inutile de rappeler, après
passage par la carte du
Oui au dernier référendum (dit de Maastricht) qui pour 80
% - correspond avec celle du vote CFDT avec des zones de
force exceptionnelles sur les salariés prolétaires
inachevés
de l’Ouest intérieur et breton.
Nous ne hasarderons
pas davantage au delà de cette simple indication de problème
d’autant plus important que dans l’Ouest la CFDT a été le
principal vecteur du captage des voix des nouveaux salariés par
le PS issu d’Epinay après l’échec du PSU et du rocardisme
isolé qui furent les premières expressions de ce mouvement qui
n’avait d’abord entraîné que des minorités militantes mais
importantes après ce vote de juin 1968 qui ne fut pas ici comme
dans l’essentiel de la France un désastre pour la Gauche. La
géographie de la CFDT est principalement induite par les socles
de la pratique catholique postrévolutionnaire (et longtemps de
la politique contre-révolutionnaire) et secondairement par les
concentrations des catégories du centre salarial. D’autres
auteurs
ont noté les affinités de l’église et des cadres moyens mais ce
qui nous intéresse le plus ici c’est le lien de cette
pratique avec d’un part une paysannerie moyenne, et
marginalement petite (plutôt modalement support de la France de
Gauche) et sa répulsion pour la grande propriété et la
prolétarisation intense qui l’a permise et qu’elle
reproduit à la fois. D’autre part l’Eglise, qui a survécu en se
mobilisant et en mobilisant ses milieux périphériques
supports a dès le 19° Siècle et sous des formes plus
transformatrices au 20°, pour survivre avec eux.
On sait qu’en
gros elle a réussi pour l’essentiel à dynamiser beaucoup
de ces milieux de la Savoie à l’Aveyron-Lozère par le Léon et la
Vendée via la modernisation de l’agriculture encadrée par
l’action catholique et via la participation active à une
accumulation indigène tardive du capital qui ne fut pas une
mince contribution à l’industrialisation de l’Ouest de 1945 à
1975. Un tissu sinon néo clérical, du moins fortement cohérent
et aux effets politiques certains ne peut pas ne pas s’induire
de cette solidarité de la propriété paysanne et ouvrière
des formes d’organisation de la prolétarisation inachevée et
d’une église ayant très nettement pris son tournant conservateur
et son projet centriste merveilleusement aidé par l’engagement
de la direction du PS lors du référendum qui ont le voit
constitue pour nous un point d’interrogation qui semble convenir
à notre type de questionnement.
Avant
d’en terminer, on esquissera un propos sur l’ambivalence
culturelle et politique de cette prolétarisation inachevée.
Historiquement en effet elle a contribué, de par les cultures
d’action directe des petits producteurs de l’Ouest,
de par la libération du travail libre et notamment du salaire et
la jubilation de vivre en pleine expansion une entrée dans le
salariat qui se confondait quasiment et paradoxalement avec leur
accès au confort, à la maison neuve à la voiture, tous traits
pour lesquels ils sont en France hors pairs dans leur propre
classe. A ceci près que l’appartenance de classe n’est pas leur
référence identitaire qui se résout, d’où leur soi disant
invisibilité sociale, à celle de composantes de peuples
dans des milieux concrets localisés et d’abord dans les
espaces ruraux où ils sont restés dans l’ouvriérisation ou avec
qui ils conservent des liens forts par le biais des lignages.
C’est pourquoi nous pensons que Mai 68 a été localement leur
affaire propre autant et plus que celle des étudiants de
Nanterre ou d’ailleurs. Leurs transferts culturels (à l’origine
poussés dans un sens critique du libéralisme par un clergé
très engagé et très idéologue) semble rejouer aujourd’hui dans
un sens au contraire très libéral et toujours en partie au
diapason de l’évolution de la direction de la CFDT, toujours
championne en anticipation opportune de l’air du temps. Il y a
là une contradiction pour qui ne verrait pas que dans le corbeillon de leurs cultures héritées il y a deux autres
apports ; le premier c’est l’individualisme
agraire
première nature d’une paysannerie de la haie et de l’habitat
dispersé, sa convergence avec le personnalisme chrétien
fortement connoté d’un solidarisme de communauté populaire dans
sa rencontre historique avec l’Action catholique des années 50
-60.
Maintenant que ce flux personnaliste communautaire est épuisé,
que les visées d’Eglise sont européennes consensuelles
autoritaires et détournées de la lutte des classes, reste
le fond traditionnel individualiste qui redevient
valorisable dans la conjoncture dominante libérale et marchande.
L’habillage personnaliste et social subsiste. Il faut donc
s’attendre à un recentrage des ouvriers prolétaires inachevés de
l’Ouest favorisé par une prise de pouvoir de la Deuxième
Gauche au sein du PS déjà très avancée mais en même temps
masquée par cette prise de pouvoir qui peut se faire sans
abandon du nouvel emblème partisan .Mais si une majorité
européenne centriste se reformait nous faisons le pari qu’il y
aurait là une base spécialement enthousiaste rêvant
de retour à la conjonction qui fut elle de la 4°
République sous l’emblème d’un européisme de cabri, pour
reprendre l’expression du Général De Gaulle.
Reste que l’ambivalence subsiste. Ce n’est qu’autant que ses acquis s’avèrent stables et transmissibles que ce basculement néoconservateur habillé de droits de l’homme peut réussir et durer. Une reprise de la prolétarisation, des délocalisations trop massives ou rapides, en un mot le poids accru du nouveau temps du monde inauguré par les Dioscures de la contre-révolution anti société salariale mondiale, la
mondialisation de R Reagan et M. Thatcher, pourraient de
nouveau faire d’eux les Jacques insurgés habillés en
soudeurs du 1955 nazairien.
Sans volonté conclusive,
la sociologie bureaucratique et abstraite, qui fut historiquement stalinienne, des classes essentialisées ne doit-elle pas laisser place à une sociologie historique économique ethnologique de la prolétarisation, complexe et relative dans ses approches, mais probablement éternisable dans sa problématique celle des
modalités concrètes de la séparation des conditions de la vie
sociale ?
Les situations réelles de prolétarisation achevée tout autant que de prolétarisation inachevées doivent toujours être spécifiées dans leur singularité sociologique (dans ou hors le salariat, etc.). La PA
n’est pas seulement ni même toujours (la communauté familiale, souvent transférable et stabilisable y
est très forte et peut constituer autant et plus une ressource qu'une charge) l’inverse de ces traits. L’exemple français
montre d’autres continuités spatiales et historiques, des
transferts de schèmes et cultures populaires singulières
spatialement situées (- contre l'illusion de prolétariat absolu passés par une "table rase" historique, mythe à virtualité totalitaire -) par leur genèse dans les paysanneries de champ ouvert habitat groupé et cultures collectives fortes (celles de la grande plaine germano-slave (?) du nord de l'Europe). Le prolétaire sans feu ni lieu et
plus encore sans passé n’est qu’un passage à la limite du
raisonnement idéologique de Marx avant de devenir le fétiche si
aisément massifiable et dépersonnalisable du stalinisme
théorique et pratique
Il n’est
plus possible de penser le devenir des mondes ouvriers sans
l’éclairage de la prolétarisation. Trop de travaux ont
déjà adjugé cette question qui n’a cependant pas encore été
affrontée pour elle même. L’article de M Verret dans Sociologie
du Travail, sur ce point complémentaire et divergente à la fois
de sa Culture ouvrière, a certes aussi mis en évidence quoique
redoutablement durci par la glissante problématique du « bas »,
cette dualité de culture qui mêle inégalement chez les
ouvriers une culture prolétarienne qui les ferait toucher
à d’autres classes, pas seulement les dangereuses
et les cultures populaires horizontales spatialisées dans
des milieux concrets qui restent un objet à peu près inconnu des
sociologues. En aucune façon cela ne préjuge des potentialités
de développement, réel ou comme type idéal d’une
culture ouvrière homogène spécifique de classe en soi comme la
préjuge toute l’œuvre de Michel Verret, mais à condition de ne
pas oublier qu’elle n’existe jamais que mêlé à ces deux autres
sources la populaire dans ses multiples modalités spatiales et
dans sa modalité verticale de rapport social, et la
prolétarienne.
Madeleine Rébérioux dans un compte rendu récent*
semblait à la fois souhaiter et redouter que soit reposé la
question de l’autonomie de la culture ouvrière posée comme cela
la question ne peut croyons nous avoir de réponse. La culture
ouvrière au singulier ne peut être que le type idéal de la
culture de classe élaborée par le sociologue abstrait ou
systématisé idéologiquement et idéalement par des institutions
de lutte sociale. Cette abstraction est un des instruments
disponible vers la connaissance, elle ne saurait en être son
aboutissement.
* 1992
Les
cultures des ouvriers réels, ici et maintenant combine
toujours les trois sources qui se résument à
deux, la culture de classe stricte quand elle est spatialement
et historiquement constituée et modalement dans le rapport à un
Etat (Nous suivons là le Marx du Manifeste contre le Verret de
la « classe en soi ») et les deux pôles des cultures
induites par la prolétarisation, culture prolétarienne
d’un côté cultures populaires antérieures et contemporaines
transférées et pour longtemps contrairement aux idéologies
modernistes - des modes de production antérieur et via la
famille unité de production des existences différenciées et non
seulement de « reproduction du capital » dans le réductionnisme
du Marx de la section VI du Capital. Meillassoux l’a
magistralement établi, de bien plus loin encore.
La salarisation n’est qu’une des possibilités
d’aboutissement social et pas toujours le principal lorsque
la séparation d’avec un fonds de travail minimal ou
d’avec une communauté d’entretien est radicalement
adjugée. (prolétarisation dans un sens absolu). Si logiquement
et historiquement la prolétarisation au delà de certains seuils
(en fait empiriquement double : expropriation radicale d’avec le
fonds de production à son compte ou libération
radicale d’avec le lien servile ou communautaire verrouillé qui
liait à un tel fond et à un maître un père ou
un conjoint) d’une part et migration loin des milieux dans
les quels familles et ménages pouvaient maintenir des entretiens
et des solidarités compensatrices) contraint à la une
quête de la salarisation . Celle-ci ne peut se confondre avec
elle et ne peut être effective qu’autant qu’une offre de
salarisation existe c’est à dire qu’une unité sociale de
capital soit en quête de capital variable à valoriser.. Cela ne
peut se déduire a priori d’autant qu’on est dans les périphéries
de l’économie monde ou dans les marges des sociétés.
On
peut donc être prolétarisé dans la petite production, être
prolétaire ni petit producteur ni salarié et vivent d’expédients
variés, et n’être que partiellement prolétarisé tout en étant
stabilisé au sein d’un travail salarié (double actif, ou
simplement salarié propriétaire travailleur au noir etc.). Le
propre du rapport de l’accumulation du capital aux modes
de production qu’elle détruit ou aux communautés domestiques
qu’elle subvertit pas seulement par l’extériorisation des
femmes, c’est de libérer beaucoup plus de forces qu’elle n’en
absorbe dans la salarisation et de trouver dans situation
concurrentielle mondiale et interne à chaque société à la fois,
qu’elle induit ainsi un des fondements principaux de ses (dé)localisations
et ses principaux profits. C’est le mode contemporain principal
de reproduction, selon la formule braudélienne l’inégalité du
monde dont il se nourrit.
Définitions
annexes et indéfiniment problématiques
Prolétaires ?
Peut-on user, sans glissades de sens, du substantif ? Beaucoup
le font et non des moindres à l’instar de Claude
Meillassoux.
Les individus séparés dans des formes de vie formellement
privatisées mais privatisables, modalement des familles, mais
sans autres ressources de leurs conditions d’existence en deçà
d’un certain seuil, classiquement (mais trop grossièrement
indiqué par leur salarisation). Cet usage approximativement
juste dans les espaces temps urbains de la première révolution
industrielle est désormais intenable avec la diversification du
salariat sauf à réserver le terme aux plus dépossédés des
salariés selon les espaces temps sociaux ? encore
faudrait-il penser comme plus prolétaires encore
(ce qui vide la notion de tout sens rigoureux) les exclus
du salariat. André Gorz pencherait vers cette substantification
et s’en défend à la fois (préférant se formule lourde mais
suggestive de non classe des non travailleurs
qui met l’accent sur à la fois tout en les confondant trop, sur
la marginalisation et sur la prolétarisation.
Peut-on dire que
le prolétaire serait l’individu adulte qui n’a pas les moyens de
se mettre à son compte pour assurer son existence ? Ce n’est pas
plus tenable, en situation très prolétarisée, au contraire la
fréquence via les petits métiers et le semi parasitisme la
bricole et la débrouillardise, peut au contraire fonctionner à
son compte, même si c’est souterrainement, de manière
habituelle. Peut-on dire que le prolétaire serait l’adulte qui
n’assure pas sa vie par lui même, ce n’est pas plus tenable car
cela interfère avec deux sous ensembles pour le moins
spécifiques celui des entretenus (femme au foyer par ex)et celui
des assistés st celui des retraités. Il vaut mieux ne pas
utiliser ce pseudo-substantif sauf à en aire le résumé
nominal d’un type idéal de la situation ou mieux de la
culture prolétarienne (Engels Verret 1989)
Certes dans cet ouvrage fondateur d’une science empirique des
mondes ouvriers que l’est la situation de la classe
laborieuse en Angleterre Engels emploie le substantif, le
prolétaire, mais pour décrire effectivement de situations
prolétariennes idéal typiques avec une culture et
une rationalité assumée propre. Mais dans toutes ces mises au
point non polémiques notamment dans les ultimes préface de
rééditions de Marx (1891 pour travail salarié capital), il n’est
plus question que de salariés de classe ouvrière d’ouvriers en
aucune façon de prolétaires même si dans leur rapport aux
bourgeoisies d’entreprises ils sont qualifiés de non possédants
raccourci qui n’a rien de scandaleux.
Prolétariat
C’est la seule entrée que l’on trouve dans ce champ sémantique
dans le Dictionnaire critique du Marxisme (G. Labica. PUF
1982). Prolétaire n’y est pas considéré comme un concept. Et
prolétarisation n’a pas droit à une entrée et ne fonctionne que
sous l’entrée immigration ce qui est significatif de
l’occultation de l’accumulation primitive continue au sein des
centres de l’économie-Monde. Ni libération ni
travailleur libre ne constituent une entrée, mais seulement
– et encore est-ce un bilan philosophique critique non un
concept-, liberté. Quel peut être le statut
gnoséologique de ce vocable ? il faut distinguer la désignation
d’une base empirique réelle quoique très minoritaire dans
toutes les populations ouvrières nationales des pays en
industrialisation et le terme générique connotant le mythe
messianique d’un sujet révolutionnaire qui ne peut se
réduire à l’usage qui en a été fait dans la mouvance communiste
du 20° où il a évidemment joué un rôle idéologique fondamental.
La culture et la pratique communistes, ce n’est pas un hasard cumula l’usage politique et l’usage sociologique de la formule spécialement à l’apogée de la massification nouvelle induite par l’irruption à l’usine de l’OS dite de façon fortement réductrice fordienne - qui lorsqu’il était
migrant, (réserve importante car lorsqu’il ne l’était pas il
était et reste souvent plus possédant que l’OQ) semblait bien
proche d’un prolétaire idéal substantivé.
Dans un usage contrôlé et modeste le prolétariat ou sens strict c’étaient dès autour de la fabrique sérielle du 19° et du 20° les agrégats d’ouvriers de l’industrie strictement réduits au salaire,( parfois mêmes interdits de famille fixe et en tout cas de résidence minimale pour une vie séparée ), par la migration, l’absence de milieux d’éventuel
retour l’absence de toute possession et réunis dans
les fabriques nouvelles de la grande industrie urbaine ou les
chantiers des grandes infrastructures(chemins de fer creusement
du port de Saint -Nazaire etc..)
Par extension le mot servi pour l’ensemble des ouvriers mais ne pouvait valoir en toute rigueur que si l’on rappelait qu’il les appréhendait exclusivement du point de vue de leur supposée et totale dépossession et de leur supposée condamnation aux seules mobilisations collectives induites par la coopération capitaliste pour réagir sur leurs conditions d’existence, à l’exclusion de toute autre détermination.
Par un troisième saut, et cette fois si dans le mythe, le prolétariat fut le mot emblème d’une (ou à propos d’une) classe ouvrière idéalement révolutionnaire et toujours aussi idéalement candidate comme telle à la direction de la société (Dictature
du prolétariat)
Est-il seulement assuré que la grande industrie
moderne de la première révolution industrielle regroupa nulle
part, sauf en Angleterre et encore des multitudes
majoritaires totalement séparées, par la combinaison d’une
dépaysannisation radicale et d’une migration vers les centres
urbains, de toute condition d’existence autre que le salaire
Rien n’est moins sûr. Au sein des marchés nationaux les
prolétariats stricts ne furent sans doute nulle part
majoritaires. Sauf peut-être en Russie. Ce qu’il importe de
comprendre c’est que de tels processus et de tels
prolétariats ont existé empiriquement et assez
spectaculairement pour induire les généralisations que l’on sait
auprès des philanthropes comme des sciences sociales naissantes.
Le rôle de Marx et d’Engels ne fut peut être pas principal dans
la genèse de cette représentation de la classe ouvrière comme
prolétariat mais celui des marxistes fut décisif
dans ce que l’on peut appeler le verrouillage de la facilité de
la diffusion de masse des pensées et la fétichisation
du syntagme dictature du prolétariat qui masqua les
analyses du capital autrement sociologiques c ‘est à dire
sensibles aux complexités d’un réel contradictoire. Bien au
contraire Marx est d’une complexité extrême si l’on parcourt le
capital à l’égard de ces dépossessions et de ses
libérations.
Prolétarisation Marginalisation Salarisation
- Le travail salarié est contradictoirement une prolétarisation dans
son essence même et en même temps le dispositif social de protection de la prolétarisation absolue, ouvert à des possibles inversions ou stabilisations inégalement précaires. En son sein même, il reste avec l’autonomie une marge pour des
variations de prolétarisation.
Il subsiste effectivement un seuil empiriquement clair
dans lequel prolétarisation et salarisation s’avèrent
strictement inséparables c’est celui de la double
séparation propre au travail salarié et au sein de ce travail
même, du travailleur d’avec l’objet le moyen et le produit
travaillé d’une part d’avec la direction du
processus de travail d’autre part. C’est la définition même du
rapport salarial. Il est vrai que dans le travail même reste peu
de choses pour une autonomie maintenue .Mais sur ce soit disant
peu de choses la sociologie du travail française a
produit maintes œuvres majeure.
On peut aussi considérer comme inégale prolétarisation sur le
travail lieu de travail les effets de déqualification qui
affectent d’obsolescence morale certaines qualifications (c’est
ce que les Baudelot et Establet de La petite
bourgeoisie
en France (Maspero) appelaient par une formule un peu rapide la
prolétarisation du prolétariat. Enfin sur le marché on peut
aussi considérer comme attribut d’inégale prolétarisation
l’employabilité inégale entre l’employabilité maximale que donne
le couple qualification/rareté et l’employabilité minimale
de l’absence de qualification et de concurrence renforcés par
l’immobilité. Encore faut-il préciser que ce qui semble
prolétarisations propres au marché s’ancre en fait sur des
sexes, des âges des positions domestiques ; la mobilité pour ne
parler que d’elle renvoie à la forme de vie, à la
famille, aux cultures d’enracinement et aussi à la
prolétarisation inachevée presque toujours ancrée au sol et
immobilisant ce qui permet d’évoquer un aspect de son
ambivalence.
_________________________________________
NOTES
2010 Ce texte a servi de base à une communication au Colloque du LERSCO Crise et métamorphoses ouvrières
Nantes 1992 et dans sa forme actuelle n'était pas destiné à l'édition. Nous le livrons fidèlement dans son état brut quitte à lui apporter progressivement les clarifications qu'avaient apporté nos travaux ultérieurs et des allègements stylistique. Il n’avait pu trouver place dans l’édition du colloque où ne fut inscrite que notre seconde communication. Ces deux textes sont complémentaires. On renvoie le lecteur à l'Harmattan. 1995 et pour partie à la rééditioàn Google. Il avait perduré, sous forme de littérature grise à l’ex bibliothèque du Lersco allègrement dispersée par le directeur du Cens il y a une dizaine d’années. La présente édition récemment exhumée de nos archives en reproduit littéralement la teneur sauf corrections élémentaires et notes datées. Nombre de ses résultats ont été publiés dans Le travailleur libre des sociétés centrales du capitalisme historique base d’une publication de cours au Département de sociologie de Nantes de 1996 à 2008. Nombre d’exemplaires en furent diffusés, jusqu’à l’Université de Strasbourg qui nous invita pour l’évoquer et des centaines d’ex étudiants en disposent sans doute encore. Il nous parait impossible que le directeur de la revue Multitude ne l’ait pas connue et intégrée à un article édité sans la moindre référence.
Constat surprenant prolétarisation, ce vocable de processus, qui tirerait Marx et ses héritiers vers l’empirie modeste du meilleur des sciences sociales, celle des formes et ses degrés, est quasiment absent dans son œuvre comme logiquement du Dictionnaire du marxisme (G. LABICA) consacré à un moment de sa systématisation universitaire. Quand au prolétaire
plus représenté dans l’œuvre, MARX s’embarrasse peu d’une théorisation et assène cette simple équation dogmatique qui encourage à l’avance ses récupérations soviétiques. Le besoin idéologique d'un prolétariat stérilise sa sociologie de la prolétarisation même pas nommée quoique traitée dans le jadis capitaliste alors qu'elle était l'avenir et que l'on imagine pas de capitalisme sans la valorisation de ce qui lui échappe encore.
CHATTOU Zoubir, Mémoire de maitrise de sociologie sous notre direction Université de Nantes 1985. Il poursuivra ce fil jusqu’à sa thèse.
MEILLASSOUX Claude, Femmes greniers& capitaux, Maspero 1975
Faut-il préciser que notre usage est à l’antipode tant de la supposée reproduction d’un « habitus de classe » de P. Bourdieu que de l’assimilation fort malheureuse (et virtuellement totalitaire dans ses conséquences communistes réelles) du Marx de la section VI du Livre I du Capital, réduisant la reproduction ouvrière à celle du capital.
Formes antérieures à la production capitaliste, texte devenu célèbre de K Marx, extrait des Manuscrits de 1857-1858 ; Grundgrisse, T 1.Editions Sociales 1980, Traduction. J P Lefebvre.
DARRAS (auteur collectif)
Minuit 1968
Avec RAGAZZI. Editions du CNRS
Marché du travail, données communautaires et stratégies individuelles, un exemple dans l’Inde contemporaine
Sociologie du Travail 1990-2
Cf., outre nos travaux sur l’autochtonie (1977, 1991)
ceux de Prado et Barbichon et dans leur fil de J Noël Rétière et Christophe Lamoureux,
Les ouvriers d’ici. Cahiers du Lersco.
Tel Père Tel Fils
Dunod
2010 Usage bourdivin du mot capital. Malgré son succès facile de marketing, cette phraséologie obscurantiste (qui ridiculise le monument conceptuel de Marx, au nom d'une vulgate marxiste
d'une grande vulgarité), est sociétalement meurtrière. Assimilant toute ressource positive acquise par le travail ou les liens de vie à un privilège gros de domination, ou d'aliénation pitoyable ( Le Bourdieu hystérisé contre la propriété domestique), il est la base d'une vision politique virtuellement terroriste dans l’institution universitaire comme dans la société.
FRIEDMANN G., NAVILLE P. Traité de Sociologie du Travail A Colin 1972
REAULT J, Les ouvriers nazairiens ou la double vie. In Ecomusée de Saint Nazaire, Saint-Nazaire et la construction navale. Réédition
www.sociologie-cultures.com
MICHELAT Guy, SIMON Michel, Classe religion et comportement politique, Editions Sociales, PFNSP 1977
WIEVIORKA Michel TRINH Sylvaine, Le modèle E.D.F. La Découverte 1989
REAULT Jacky, Ouvriers de l’Ouest, in ATP CNRS, L’Ouest bouge-t-il ? 1983 Nantes Vivant
LE BRAS Hervé, Les Trois France Seuil 1986
LE ROY-LADURIE E, Le territoire de l’historien. Idées. Gallimard. 1973.
Septembre 2010. Lire sur ce point notre Les ouvriers de la classe au peuple
in
www.sociologie-cultures.com
JR 1977, La prolétarisation inachevée. Université de Nantes LERSCO, reprise dans JR. Prolétarisation communauté domestique et lieu de travail: les ouvriers de l’aire d’emploi de Saint Nazaire. Bulletin de la Société Française de Sociologie Novembre 1977.
J R 1983, O.c, CUTURELLO Paul,, GODARD Francis,, Familles mobilisées Plan Construction 1980, J R Formes de vie ouvrière et écosystèmes sociaux de reproduction. Lersco. C NRS 1989
TODD Emmanuel La troisième planète Seuil 1983. 2010, et depuis, plus totalisant pour la France,
l’Invention de l’Europe 1993.
DENIOT Joëlle, avec DUTHEIL C, in Crise et métamorphose ouvrière, L’Harmattan 1995, J REAULT, "Mondes ouvriers et peuples horizontaux", notre autre communication.
Sur ce point et plus encore comme exemplification réelle exemplaire d’une culture politique de prolétarisation achevée dans le salariat, DENIOT Joëlle, La coopération ouvrière à l’usine des Batignolles. Paris Anthropos 1983 et en liens de coopération sociologique, REAULT J., Histoire d’une usine au 20° siècle Les Batignolles de Nantes, L’usine et la vie. In Norois. Changement social et culturel dans l’ouest. Octobre décembre 1981. C’est aussi notre premier peuple nazairien (1991, 1995) 2010 : Vr Les ouvriers de Saint-Nazaire ou la double vie in
www.sociologie-cultures.com
On rappelle que le passage au singulier idéologisé de
classe ouvrière, est second et lié à la rencontre avec Marx, de l’ethnographe ( ?) F.ENGEL (La situation des classes laborieuses en Angleterre) qui recule derrière l’eschatologie communiste mâtinée de la rédemption par une classe investie d’une mission,
le prolétariat, cette invention si mal aboutie au 20° siècle.
Septembre 2010. La sociologie politique la plus concrète, celle de notre article Nicolas et Ségolène ou le mystère de la dame de Vix in J DENIOT, J REAULT, Espaces Temps et territoires.
Nantes Lestamp Edition 2010, - réédité, après épuisement de l'édition, sur www.sociologie-cultures.com fait jusqu’à présent rejouer ces partitions historiques et spatiales et cette
typologie de la prolétarisation et notamment quand la polarisation du vote présidentiel français atteint une idéaltypicité aussi fascinante que celui du printemps 2007. Nous l'avons dans de nombreux travaux depuis 1977 éprouvée sur l'étude des appartenances et du vote syndical. Dernière publication significative,
Les trente glorieuses de la CGT nazairienne et les aléas de la mondialisation. In La CGT en Bretagne. Un centenaire, Dir Claude. Geslin, Annales de Bretagne et des pays de l'ouest. 1995-3.
Il ne s’agit pas pour nous d’une disqualification, ni du moindre jugement rééducateur, nous laissons l’antifamilialisme
aux sociologies de l’invective antipeupliste ou à ceux de la rupture avec la communalité humaine du sens commun.
REAULT J Formes de vie ouvrières et écosystèmes sociaux de reproduction. Université de Nantes. Lersco 1989.
La métamorphose de la société salariale. Calmann-Lévu 1984.
Pour les lecteurs pressés le très lumineux BRAUDEL F., La dynamique du capitalisme.
Paris Arthaud 1984
DUBOIS Pierre, dans sa thèse Les travaux ouvriers plus que dans le livre Les ouvriers divisés PFNSP).
______________________________ BIBLIOGRAPHIE Réédition de septembre 2010
Une bibliographie scientifique sera explicitée au fil de la gestion de ce site; elle ne saurait qu'exceptionnellement élargir les références explicitées dans le texte, sauf oubli. .
Concernant nos travaux publiés, la problématique de la prolétarisation se trouve appliquée, pratiquement mais sans grandes explicitations théoriques, dans
- Norois, Changements sociaux et culturels dans l'Ouest 1981, L'usine des Batignolles à Nantes. (réédition Persée, sur le web) - ATP CNRS, L'Ouest bouge-t-il ? Ed. Vivant Nantes 1983. J R Ouvriers de l'Ouest. -Ecomusée de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire et la construction navale, JR Les ouvriers nazairiens ou la double vie. Saint-Nazaire 1993 -Annales de Bretagne et des Pays de l'ouest, Claude Geslin Dir., La CGT en Bretagne, J R, Les Trente Glorieuses de la CGT nazairienne et les aléas de la mondialisation. Réédition Persée. Concernant la problématique de la prolétarisation en sciences politiques et notamment en sociologie électorale,
Jacky Réault, Nicolas et Ségolène ou le mystère de la Dame de Vix, in J Deniot, J Réault, avec L Delmaire, Espaces, temps et territoires. Lestamp Nantes 2010.
Une analyse en profondeur spatiale historique et statistique des socles sociétaux et anthropologiques, des degrés et formes de prolétarisation qui rendent compte des votes présidentiels et notamment populaires et ouvriers.
Droits de reproduction et de diffusion réservés © LESTAMP - 2010
Dépôt Légal Bibliothèque Nationale de France
LERSCO- CNRS 1987
Droits de reproduction et de diffusion réservés © LESTAMP - 2010
Dépôt Légal Bibliothèque Nationale de France
Choix d'œuvres de Jacky Réault sur les formes de la prolétarisation ouvrière
...prolétarisation achevée dans le salariat 1981 - 1993
...prolétarisation inachevée dans le salariat 1992 1994 |
|



